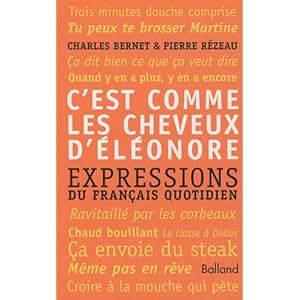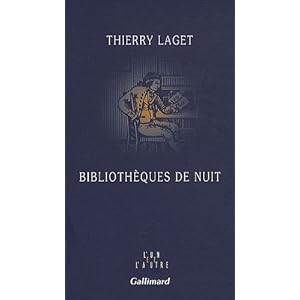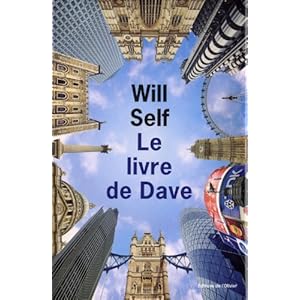Charles BERNET et Pierre RÉZEAU, C'est comme les cheveux d'Éléonore - Expressions du français quotidien, Balland, Paris, octobre 2010 (945 pages).
J'ai toujours aimé les dictionnaires. C'est du voyage à peu de frais, pas besoin de vous déshabiller ni de vous faire palper à l'aéroport, pas de danger d'attraper quelque tourista et aucun risque de mouvement social vous laissant valise à la main à la porte de votre hôtel.
J'ai déjà commencé à me perdre dans celui-ci, dont la lecture est à la fois instructive et roborative. Un regret, toutefois : c'est très hexagonal. Invitation est donc lancée à quelque retraité d'ici pour nous offrir d'ici peu un Prendre son gaz égal ou autre Péter sa coche. Un reproche, l'index n'est pas très lisible : il vous sera impossible de trouver l'expression à l'origine du titre sauf, comme moi, par hasard, sous l'entrée Encore comme « variante développée » de l'expression Quand (il) n'y en a plus, (il) y en a encore : C'est comme les cheveux d'Éléonore, quand il n'y en a plus, il y en a encore.
lundi 29 novembre 2010
vendredi 26 novembre 2010
Une saison avec Bernard Frank -- portrait
Martine de RABAUDY, Une saison avec Bernard Frank -- portrait, Flammarion, Paris, avril 2101 (141 pages).
En exergue de ce bref portrait de Bernard FRANK, disparu en novembre 2006, et dont j'ai récemment lu Solde, en attendant de poursuivre avec les divers recueils de ses chroniques, cette citation de Vladimir NABOKOV :
« Ce qu'il y a de meilleur dans la biographie d'un auteur, ce n'est pas le récit de ses aventures mais l'histoire de son style. »
FRANK, c'était sans conteste un style. C'est un peu bizarre de traiter d'un livre sur un auteur que peu de gens connaissent, dont l'œuvre est constituée principalement de chroniques (L'Express, Le Matin, Le Monde, Le Nouvel Observateur), outre quelques romans et essais, d'ailleurs difficiles à trouver, même en bibliothèque. Pour une fois, il n'est pas question de PROUST, se réjouiront tels de mes amis, qui me sont très chers (on le sait, l'amitié n'a pas de prix), membres du très large club des lecteurs « qui ont commencé, mais qui n'arrivent pas à poursuivre, c'est de la littérature pour retraités... » et qu'irritent mes allers-retours incessants dans la Recherche, dont je sais qu'ils ne la liront jamais, le cliché est tellement plus pratique et confortable. Mais Bernard FRANK, allons donc, ce n'est pas sérieux, et pis encore, un livre sur Bernard FRANK ! Mais comme je les lisais, ces chroniques de l'Obs, souvent avec délectation, parfois avec irritation, mais toujours avec intérêt, que j'ai lu, sans beaucoup les aimer, deux de ses romans, et que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire Solde, ce sera ma façon, muette et inutile, de lui rendre hommage.
Présentation de l'éditeur :
En exergue de ce bref portrait de Bernard FRANK, disparu en novembre 2006, et dont j'ai récemment lu Solde, en attendant de poursuivre avec les divers recueils de ses chroniques, cette citation de Vladimir NABOKOV :
« Ce qu'il y a de meilleur dans la biographie d'un auteur, ce n'est pas le récit de ses aventures mais l'histoire de son style. »
FRANK, c'était sans conteste un style. C'est un peu bizarre de traiter d'un livre sur un auteur que peu de gens connaissent, dont l'œuvre est constituée principalement de chroniques (L'Express, Le Matin, Le Monde, Le Nouvel Observateur), outre quelques romans et essais, d'ailleurs difficiles à trouver, même en bibliothèque. Pour une fois, il n'est pas question de PROUST, se réjouiront tels de mes amis, qui me sont très chers (on le sait, l'amitié n'a pas de prix), membres du très large club des lecteurs « qui ont commencé, mais qui n'arrivent pas à poursuivre, c'est de la littérature pour retraités... » et qu'irritent mes allers-retours incessants dans la Recherche, dont je sais qu'ils ne la liront jamais, le cliché est tellement plus pratique et confortable. Mais Bernard FRANK, allons donc, ce n'est pas sérieux, et pis encore, un livre sur Bernard FRANK ! Mais comme je les lisais, ces chroniques de l'Obs, souvent avec délectation, parfois avec irritation, mais toujours avec intérêt, que j'ai lu, sans beaucoup les aimer, deux de ses romans, et que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire Solde, ce sera ma façon, muette et inutile, de lui rendre hommage.
Présentation de l'éditeur :
« Qu'il soit attablé dans un grand restaurant parisien, installé avec son whisky en Normandie chez l'inséparable Françoise Sagan, ou reclus dans la campagne varoise pour écrire auprès d'une belle anglaise, Bernard Frank tour à tour fascine, charme, agace voire exaspère. II suscite des jalousies littéraires, éveille des passions féminines, porte des jugements iconoclastes dans ses chroniques pour L'Express, Le Matin, Le Monde, Le Nouvel Observateur, un demi-siècle durant. Enfin et surtout, ce dilettante éclairé laisse une oeuvre inimitable de mémorialiste où perce son amour fou de la littérature et des femmes, " dans cet ordre ", comme il aime à le préciser, et où il assume avec une grâce égale à son ironie cette contradiction de la peur de mourir et de l'angoisse de vivre.
» Martine de Rabaudy prend, elle, le temps d'écouter Frank et ses amis, Florence Malraux, Claude Perdriel, Frédéric Vitoux, Jean-Paul Kauffmann, Eric Neuhoff ou Raphaël Sorin, pour brosser un portrait de l'homme personnel et généreux, débordant d'humour et de finesse ; un portrait d'écrivain. »
mercredi 24 novembre 2010
Bibliothèques de nuit
Thierry LAGET, Bibliothèques de nuit, L'un et l'autre, Gallimard, mai 2010 (83 pages).
Plutôt que de tenter de résumer ces beaux récits de Thierry LAGET, dans la très belle collection L'un et l'autre, dont je fais, justement, collection, j'ai pensé à vous en donner quelques phrases, avec l'espoir qu'elles vous donneront le goût d'accompagner les rêveries nocturnes et bibliophiles de l'auteur.
« L'enfance flotte en notre souvenir comme une abeille dans une larme d'ambre. Ses jours continuent de bourdonner dans les siècles, quoique désormais nous ne contemplions plus que leur vol pétrifié. » Les yeux au ciel
« Un jour, les archéologues découvriront l'art sur les boîtes de chocolat comme ils ont exhumé de Palmyre ou Ninive après des années de fouilles au désert, et ils tomberont à la renverse. » Hiver de chocolat
« On vieillit. La terre boit les jours qui débordent comme un verre de mousseux qu'on a versé trop vite...» Parques de Sceaux
« Un bateau s'est posé sur le lac : c'est un petit navire aigu, caparaçonné de fer, boutonné de rivets, portant un collier de hublots, deux ponts et une cheminée à peine plus haute qu'un carton à chapeaux. » Paysage de Dalécarlie
« La nuit, pour peu qu'on laisse la fenêtre ouverte, le parfum des fleurs d'oranger s'insinue dans les chambres... » Le songe de Polyphème
Plutôt que de tenter de résumer ces beaux récits de Thierry LAGET, dans la très belle collection L'un et l'autre, dont je fais, justement, collection, j'ai pensé à vous en donner quelques phrases, avec l'espoir qu'elles vous donneront le goût d'accompagner les rêveries nocturnes et bibliophiles de l'auteur.
« L'enfance flotte en notre souvenir comme une abeille dans une larme d'ambre. Ses jours continuent de bourdonner dans les siècles, quoique désormais nous ne contemplions plus que leur vol pétrifié. » Les yeux au ciel
« Un jour, les archéologues découvriront l'art sur les boîtes de chocolat comme ils ont exhumé de Palmyre ou Ninive après des années de fouilles au désert, et ils tomberont à la renverse. » Hiver de chocolat
« On vieillit. La terre boit les jours qui débordent comme un verre de mousseux qu'on a versé trop vite...» Parques de Sceaux
« Un bateau s'est posé sur le lac : c'est un petit navire aigu, caparaçonné de fer, boutonné de rivets, portant un collier de hublots, deux ponts et une cheminée à peine plus haute qu'un carton à chapeaux. » Paysage de Dalécarlie
« La nuit, pour peu qu'on laisse la fenêtre ouverte, le parfum des fleurs d'oranger s'insinue dans les chambres... » Le songe de Polyphème
lundi 22 novembre 2010
À quoi servent les prix littéraires ?
Une entrevue réalisée par le Nouvel Observateur avec Sylvie DUCAS, maître de conférence et auteur de plusieurs travaux portant sur les prix littéraires (cliquez sur le titre de l'article).
Magique étude du bonheur
Vincent CESPEDES, Magique étude du bonheur, Larousse, Paris, avril 2010 (238 pages).
Ayant entendu l'auteur lors d'une récente émission de France Culture Du grain à moudre, j'ai réservé ce livre à la bibliothèque et, l'ayant reçu à temps, j'ai pu le prendre avec moi à Cayo Largo. Quoi de mieux que de lire sur le bonheur les pieds dans le sable ?
Une étude qui, la chose est rare, n'est pas un livre de recette. Ni sur le bonheur, ni sur l'amour. Le travail de l'auteur porte sur ce qu'il appelle « les institutions », le bonheur constituant pour lui une des valeurs construites par la société. Une idéologie, en quelque sorte.
L'auteur a recours à la figure d'un génie qui lui offre de réaliser un vœu. Et sa réflexion, et la nôtre, de ce fait, suit le dialogue qui s'établit entre l'un et l'autre. Des choix purement égoïstes (être riche) ou narcissiques (être beau) on passe à des choix altruistes (fin de l'injustice, de la pauvreté), fussent-ils utopiques. Ce qui lui permet de peaufiner sa définition de la notion de bonheur.
La figure de RIMBAUD occupe une place importante dans l'essai. Il serait, selon l'auteur, l'incarnation de la pensée, très années soixante-dix, que le bonheur c'est l'être. Or, on peut très bien être dans l'être et ne pas être heureux, ce qui, selon l'auteur, serait le cas du poète lequel s'est montré, en dépit de son génie, de la subversion, de la spontanéité, de son sens de l'aventure incapable d'entrer en contact avec l'autre ou de communiquer avec lui. La thèse de l'auteur est que le bonheur est dans le « rendre » : la meilleure façon d'être heureux est de rendre l'autre heureux. Et l'auteur oppose le poète au personnage principal du film Happy Go Lucky de Mike LEIGH, qui, en dépit d'un quotidien souvent difficile, s'intéresse aux autres, pas tant en ce qu'elle veut leur bonheur -- la volonté de bonheur, ou le bonheur obligatoire, étant, on le sait, une des caractéristiques des totalitarismes, religieux ou politiques, mais que sa simplicité, son attitude face à la vie contribue à rendre les autres heureux : une onde de bonheur.
Mais, il y a un mais : voilà l'exemple même du livre que j'adore détester (ou, inversement, que je déteste aimer). Pas question, certes, de tenir rigueur à l'auteur de sa jeunesse; mais je lui fais grief du style jeuniste et branchouillard. Ce qui a complètement ruiné ma lecture, et c'est bien dommage, car j'ai adhéré au propos de l'auteur, notamment dans sa dénonciation du « bonheurisme » forcené de la société de consommation occidentale et des donneurs de recettes (qu'à l'évidence il n'est pas). Et, pour donner dans son style, son djinn tonique m'a plutôt agacé.
Si vous y tenez, écoutez une entrevue d'une vingtaine de minutes avec l'auteur à la SRC. Pour une fois, la dame du micro parvient à lui laisser la parole.



Ayant entendu l'auteur lors d'une récente émission de France Culture Du grain à moudre, j'ai réservé ce livre à la bibliothèque et, l'ayant reçu à temps, j'ai pu le prendre avec moi à Cayo Largo. Quoi de mieux que de lire sur le bonheur les pieds dans le sable ?
Une étude qui, la chose est rare, n'est pas un livre de recette. Ni sur le bonheur, ni sur l'amour. Le travail de l'auteur porte sur ce qu'il appelle « les institutions », le bonheur constituant pour lui une des valeurs construites par la société. Une idéologie, en quelque sorte.
L'auteur a recours à la figure d'un génie qui lui offre de réaliser un vœu. Et sa réflexion, et la nôtre, de ce fait, suit le dialogue qui s'établit entre l'un et l'autre. Des choix purement égoïstes (être riche) ou narcissiques (être beau) on passe à des choix altruistes (fin de l'injustice, de la pauvreté), fussent-ils utopiques. Ce qui lui permet de peaufiner sa définition de la notion de bonheur.
La figure de RIMBAUD occupe une place importante dans l'essai. Il serait, selon l'auteur, l'incarnation de la pensée, très années soixante-dix, que le bonheur c'est l'être. Or, on peut très bien être dans l'être et ne pas être heureux, ce qui, selon l'auteur, serait le cas du poète lequel s'est montré, en dépit de son génie, de la subversion, de la spontanéité, de son sens de l'aventure incapable d'entrer en contact avec l'autre ou de communiquer avec lui. La thèse de l'auteur est que le bonheur est dans le « rendre » : la meilleure façon d'être heureux est de rendre l'autre heureux. Et l'auteur oppose le poète au personnage principal du film Happy Go Lucky de Mike LEIGH, qui, en dépit d'un quotidien souvent difficile, s'intéresse aux autres, pas tant en ce qu'elle veut leur bonheur -- la volonté de bonheur, ou le bonheur obligatoire, étant, on le sait, une des caractéristiques des totalitarismes, religieux ou politiques, mais que sa simplicité, son attitude face à la vie contribue à rendre les autres heureux : une onde de bonheur.
Mais, il y a un mais : voilà l'exemple même du livre que j'adore détester (ou, inversement, que je déteste aimer). Pas question, certes, de tenir rigueur à l'auteur de sa jeunesse; mais je lui fais grief du style jeuniste et branchouillard. Ce qui a complètement ruiné ma lecture, et c'est bien dommage, car j'ai adhéré au propos de l'auteur, notamment dans sa dénonciation du « bonheurisme » forcené de la société de consommation occidentale et des donneurs de recettes (qu'à l'évidence il n'est pas). Et, pour donner dans son style, son djinn tonique m'a plutôt agacé.
Si vous y tenez, écoutez une entrevue d'une vingtaine de minutes avec l'auteur à la SRC. Pour une fois, la dame du micro parvient à lui laisser la parole.

samedi 20 novembre 2010
Salon du livre
C'est un titre trompeur : en fait, je ne vais pas au salon du livre. Je n'aime pas les foires commerciales, et surtout les commerciales qui s'affirment culturelles; je n'aime pas les foules qui les fréquentent et encore moins les agités qui s'y agitent. Surtout que Mlle B***, la dame de Très Grande Vertu hypermédiatique y est sûrement. Je suis de la vieille école (dans tous les sens du terme : j'ai appris à lire, à écrire et à compter) : ce que l'on appelle dans les médias si importants un élitiste. Pour moi, le salon du livre (pas besoin de majuscule) est à la librairie ce que le Costco est au commerce en général. Je n'aime pas.
Si je savais écrire, j'aurais écrit l'article de FOGLIA : Un roman juif.
Si je savais écrire, j'aurais écrit l'article de FOGLIA : Un roman juif.
vendredi 19 novembre 2010
Ainsi vivent les morts
Will SELF, Ainsi vivent les morts, traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Francis Kerline, titre original : How the Dead Live, Éditions de l’Olivier, Paris, 2001 (438 pages).
Will SELF est de ces auteurs, encore jeunes, qui secouent la baraque, tant dans leur vie privée, torrentueuse, que dans les Lettres. Et dont les sujets et le style ne sauraient laisser indifférent. Attention, il n’est pas de ceux que le narcissisme, à défaut de talent, pousse à exhiber sur papier les génitoires et les prouesses de trottoir ou d’alcôve. On aurait tord de ne pas essayer de faire sa connaissance, d’autant plus qu’on sort du roman un peu secoué par l’audace du propos et de la forme. Voici qu’il est question de mort ou, plutôt – que l’oxymore nous soit pardonné – , de la vie de la mort, c’est à dire une fois passé le seuil du trépas. Le tout dans un roman qu’on pourrait dire d’eau de javel et fleur artificielle comme d’autres sont à l’eau de rose et fleur bleue.
1988. Lily Bloom, la soixantaine, juive antisémite et fausse goy, américaine mais établie en Angleterre, se meurt du cancer du sein. Les curieux compareront la fin du roman à celle du Ulysses de James JOYCE. Le roman s’ouvre par l’épilogue – quand on conduit à gauche, on peut bien commencer par la fin... et comporte trois parties : Mourante, Morte, Encore plus morte. Le ton est donné. De vieilles rancœurs en acrimonies mesquines, Lily vit ses derniers jours entre un corridor d’hôpital et les souvenirs rances de sa médiocre existence. Haine de la maladie qui la ronge, des médecins à la langue de bois, de sa propre condition de loque pourrissante. Deux filles, Charlotte, aspirante bourgeoise, et Natasha droguée séduisante. Le souvenir d’un fils mort dans un stupide accident. Deux maris, morts évidemment. Toute une vie pour rien ?
Le lecteur apprendra que, une fois poussé le dernier râle, la morte ne quitte pas vraiment l’univers réel. Elle devient seulement moins tangible, mais dépourvue de sensibilité. Elle ne fait que déménager en somme: un sordide sous-sol dans une non moins sordide banlieue de Londres, semblable au quartier où elle a vécu. Londres où l’on trouve deux sortes de restaurants : « les mauvais et les pire ». Lily y est menée dans un taxi conduit par un Chypriote grec, successeur de Charon, et prise en charge par un autochtone australien du nom de Phar Lap Jones, un ange gardien, en quelque sorte. Les jours passent, il lui faut assister aux séances d’initiation à la mort. Apprendre les douze étapes et les douze traditions des « Personnellement Morts ». Prendre un emploi. Et surtout s’habituer à la bureaucratie tatillonne des défunts, la « mortocratie ». Lily ne peut se faire aux plaintes de trois ectoplasmes, constitués de toutes les graisses qu’elle a perdues et reprises de son vivant,! et qui ne la quittent plus. Ce qui ne contribuera pas à améliorer son caractère. Et puis, il y a toujours des nouveaux, expédiés par les nombreux attentats que connaît le Londres des années quatre-vingt-dix. Une fois installée dans ses meubles, l’épicerie et le ménage faits, Lily ne pourra pas s’empêcher d’observer de près ses filles. Elle n’est pas un fantôme, qu’on ne se méprenne pas, elle ne peut tout simplement pas laisser les vivants vivre leur vie. Comprendra-t-elle, comme le lui suggère Phar Lap Jones, qu’elle doit faire le deuil de sa propre vie ? Si elle veut enfin, qui sait, revenir. Au fait, le myosotis n’est-il pas aussi appelé « ne m’oubliez pas » ?
Will SELF a déjà, dans nouvelle publiée en 2000, Le livre des morts de Londres-nord, exploré le thème de la vie après la mort, où le narrateur rencontrait feu sa mère. Comme dans ses autres romans, il met en scène un univers parallèle qu’on sait n’être que fiction, hallucinée, mais qui semble si réaliste. Et s’il prête la voix à Lily, il ne se départit pas, dans les digressions où elle amène le lecteur – au risque parfois de le perdre – de l’ironie acide qui rend le roman tout sauf lugubre. Une vie, une mort peuvent-elles se résumer en cette succession de frustrations ? Cette rage accumulée ? On l’avouera, devant tant de haine, le lecteur pourrait se lasser. Mais il devra persévérer, « la colère, c’est aussi ce qui me maintient en vie » dit Lily. Au bout du compte, elle n’est pas différente des héroïnes de romans Harlequin, où tout est pastel. Elle en est simplement le négatif glauque. ARAGON a écrit, et FERRÉ chanté: Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Question toujours actuelle.



Will SELF est de ces auteurs, encore jeunes, qui secouent la baraque, tant dans leur vie privée, torrentueuse, que dans les Lettres. Et dont les sujets et le style ne sauraient laisser indifférent. Attention, il n’est pas de ceux que le narcissisme, à défaut de talent, pousse à exhiber sur papier les génitoires et les prouesses de trottoir ou d’alcôve. On aurait tord de ne pas essayer de faire sa connaissance, d’autant plus qu’on sort du roman un peu secoué par l’audace du propos et de la forme. Voici qu’il est question de mort ou, plutôt – que l’oxymore nous soit pardonné – , de la vie de la mort, c’est à dire une fois passé le seuil du trépas. Le tout dans un roman qu’on pourrait dire d’eau de javel et fleur artificielle comme d’autres sont à l’eau de rose et fleur bleue.
1988. Lily Bloom, la soixantaine, juive antisémite et fausse goy, américaine mais établie en Angleterre, se meurt du cancer du sein. Les curieux compareront la fin du roman à celle du Ulysses de James JOYCE. Le roman s’ouvre par l’épilogue – quand on conduit à gauche, on peut bien commencer par la fin... et comporte trois parties : Mourante, Morte, Encore plus morte. Le ton est donné. De vieilles rancœurs en acrimonies mesquines, Lily vit ses derniers jours entre un corridor d’hôpital et les souvenirs rances de sa médiocre existence. Haine de la maladie qui la ronge, des médecins à la langue de bois, de sa propre condition de loque pourrissante. Deux filles, Charlotte, aspirante bourgeoise, et Natasha droguée séduisante. Le souvenir d’un fils mort dans un stupide accident. Deux maris, morts évidemment. Toute une vie pour rien ?
Le lecteur apprendra que, une fois poussé le dernier râle, la morte ne quitte pas vraiment l’univers réel. Elle devient seulement moins tangible, mais dépourvue de sensibilité. Elle ne fait que déménager en somme: un sordide sous-sol dans une non moins sordide banlieue de Londres, semblable au quartier où elle a vécu. Londres où l’on trouve deux sortes de restaurants : « les mauvais et les pire ». Lily y est menée dans un taxi conduit par un Chypriote grec, successeur de Charon, et prise en charge par un autochtone australien du nom de Phar Lap Jones, un ange gardien, en quelque sorte. Les jours passent, il lui faut assister aux séances d’initiation à la mort. Apprendre les douze étapes et les douze traditions des « Personnellement Morts ». Prendre un emploi. Et surtout s’habituer à la bureaucratie tatillonne des défunts, la « mortocratie ». Lily ne peut se faire aux plaintes de trois ectoplasmes, constitués de toutes les graisses qu’elle a perdues et reprises de son vivant,! et qui ne la quittent plus. Ce qui ne contribuera pas à améliorer son caractère. Et puis, il y a toujours des nouveaux, expédiés par les nombreux attentats que connaît le Londres des années quatre-vingt-dix. Une fois installée dans ses meubles, l’épicerie et le ménage faits, Lily ne pourra pas s’empêcher d’observer de près ses filles. Elle n’est pas un fantôme, qu’on ne se méprenne pas, elle ne peut tout simplement pas laisser les vivants vivre leur vie. Comprendra-t-elle, comme le lui suggère Phar Lap Jones, qu’elle doit faire le deuil de sa propre vie ? Si elle veut enfin, qui sait, revenir. Au fait, le myosotis n’est-il pas aussi appelé « ne m’oubliez pas » ?
Will SELF a déjà, dans nouvelle publiée en 2000, Le livre des morts de Londres-nord, exploré le thème de la vie après la mort, où le narrateur rencontrait feu sa mère. Comme dans ses autres romans, il met en scène un univers parallèle qu’on sait n’être que fiction, hallucinée, mais qui semble si réaliste. Et s’il prête la voix à Lily, il ne se départit pas, dans les digressions où elle amène le lecteur – au risque parfois de le perdre – de l’ironie acide qui rend le roman tout sauf lugubre. Une vie, une mort peuvent-elles se résumer en cette succession de frustrations ? Cette rage accumulée ? On l’avouera, devant tant de haine, le lecteur pourrait se lasser. Mais il devra persévérer, « la colère, c’est aussi ce qui me maintient en vie » dit Lily. Au bout du compte, elle n’est pas différente des héroïnes de romans Harlequin, où tout est pastel. Elle en est simplement le négatif glauque. ARAGON a écrit, et FERRÉ chanté: Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Question toujours actuelle.

Je ne lirai pas
Will SELF, Le livre de Dave -- Une révélation du passé récent et de l'avenir lointain, traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Robert DAVREU, titre original : The Book of Dave, Éditions de l'Olivier, Paris, août 2010, (539 pages).
J'ai, il y a une dizaine d'années, suivi Will SELF, quand il commençait à être connu en France, notamment avec La théorie quantitative de la démence (recueil de nouvelles), Ainsi vivent les morts (dont je reprends le commentaire de lecture dans un article séparé) et Dorian (tous ces livres ont été repris au Seuil dans la collection de poche Points; je l'ai, par la suite, un peu perdu de vue. C'est un auteur dont j'aime le style et les thèmes qu'il aborde, et dont je me faisais une joie de lire le nouveau roman, que je viens d'aller prendre à la bibliothèque.
Un clic sur le titre de l'article ouvre le commentaire publié en anglais dans Wikipedia sur Le livre de Dave.
Rappelons que ce livre a été publié en anglais en 2006 et paraît en français après No Smoking, traduction de The Butt, qui date de 2009. Je crois que c'est la difficulté à traduire ce roman qui explique ce retard de publication.
C'est un fort volume que ce roman, plus de cinq-cents pages. Ce qui, le plus souvent, ne me détourne pas, moi qui suis habitué aux longueurs proustiennes ! Mais ici, j'avoue qu'après une petite dizaine de pages, je renonce à pousser plus avant la promenade... ou, plus précisément, l'escalade. Je m'arrête parce que je suis un peu rebuté par la langue, créée par l'auteur, dont on peut admirer l'inventivité, et qu'il donne à ce monde de Ham, ville de « l'Ingleterre », où se déroule, dans deux mille ans, une partie de l'intrigue, alors que des survivants à un cataclysme ont découvert le livre de Dave, et en ont fait leur référence spirituelle. Cette langue, le mokni est une sorte d'argot modelé sur le jargon de Dave Rudman, un chauffeur de taxi de notre époque, dont l'histoire constitue l'autre partie du roman. Est annexé à l'ouvrage, un Glossaire français analogique du dialecte mokni parlé à Ham.
Tour de force d'écriture, certes, et de traduction, c'est évident.
Lâcheté ou paresse ? Une grosse fatigue s'est emparé de moi, devant la perspective d'incessants allers-retours au glossaire pour mieux comprendre ce que je lisais. Très grosse fatigue, même. J'ai donc décidé de surseoir à la lecture et, partant, au commentaire de ce roman. Partie remise, je vous l'assure, ce genre de roman étant, en général, fort de mon goût.
Vous y risquerez vous ?
Présentation de l'éditeur :






J'ai, il y a une dizaine d'années, suivi Will SELF, quand il commençait à être connu en France, notamment avec La théorie quantitative de la démence (recueil de nouvelles), Ainsi vivent les morts (dont je reprends le commentaire de lecture dans un article séparé) et Dorian (tous ces livres ont été repris au Seuil dans la collection de poche Points; je l'ai, par la suite, un peu perdu de vue. C'est un auteur dont j'aime le style et les thèmes qu'il aborde, et dont je me faisais une joie de lire le nouveau roman, que je viens d'aller prendre à la bibliothèque.
Un clic sur le titre de l'article ouvre le commentaire publié en anglais dans Wikipedia sur Le livre de Dave.
Rappelons que ce livre a été publié en anglais en 2006 et paraît en français après No Smoking, traduction de The Butt, qui date de 2009. Je crois que c'est la difficulté à traduire ce roman qui explique ce retard de publication.
C'est un fort volume que ce roman, plus de cinq-cents pages. Ce qui, le plus souvent, ne me détourne pas, moi qui suis habitué aux longueurs proustiennes ! Mais ici, j'avoue qu'après une petite dizaine de pages, je renonce à pousser plus avant la promenade... ou, plus précisément, l'escalade. Je m'arrête parce que je suis un peu rebuté par la langue, créée par l'auteur, dont on peut admirer l'inventivité, et qu'il donne à ce monde de Ham, ville de « l'Ingleterre », où se déroule, dans deux mille ans, une partie de l'intrigue, alors que des survivants à un cataclysme ont découvert le livre de Dave, et en ont fait leur référence spirituelle. Cette langue, le mokni est une sorte d'argot modelé sur le jargon de Dave Rudman, un chauffeur de taxi de notre époque, dont l'histoire constitue l'autre partie du roman. Est annexé à l'ouvrage, un Glossaire français analogique du dialecte mokni parlé à Ham.
Tour de force d'écriture, certes, et de traduction, c'est évident.
Lâcheté ou paresse ? Une grosse fatigue s'est emparé de moi, devant la perspective d'incessants allers-retours au glossaire pour mieux comprendre ce que je lisais. Très grosse fatigue, même. J'ai donc décidé de surseoir à la lecture et, partant, au commentaire de ce roman. Partie remise, je vous l'assure, ce genre de roman étant, en général, fort de mon goût.
Vous y risquerez vous ?
Présentation de l'éditeur :
« Et si le pire des hommes devenait le Messie ? Dave Rudman, chauffeur de taxi londonien, passe son temps, à fulminer contre les Noirs, les Juifs, les Arabes, les bourgeois ou les touristes. Il déverse son fiel dans des écrits qu'il enterre dans le jardin de son ex-femme, Michelle. Cinq siècles plus tard, après un terrible déluge, ses élucubrations sont retrouvées. Le " Livre de Dave " devient la référence spirituelle du Nouveau Monde. Dans l'archipel d'Ingleterre, en l'an 500 après Dave, la vie s'organise selon les paroles du prophète. Les hommes et les femmes vivent séparément, et parlent le mokni, argot modelé sur le jargon du chauffeur de taxi.
» Cet " Evangile selon Self " est une satire de la vie moderne. Les religions, le capitalisme, l'Histoire, le mariage, rien n'échappe à l'auteur de Mon idée du plaisir. Vrai-faux roman d'anticipation ou d'aventures, Le Livre de Dave est surtout un tour de force littéraire. Will Self invente une langue, un monde, mélange les genres et les influences avec une virtuosité impressionnante. »


jeudi 18 novembre 2010
En être ou ne pas en être
France Culture, Les nouveaux chemins, une émission de Raphaël ENTHOVEN.
Dans le cadre d'un semaine sur le snobisme, l'émission consacrée au snobisme de PROUST, ou plus précisément, au snobisme dans la Recherche du temps perdu. Brillamment exposé par Donatien GRAU, enseignant à l'École normale supérieure (ENS) et membre de l'équipe Proust du Centre national de la Recherche scientifique (CNRS).
Même si vous n'êtes pas familiers avec l'œuvre, écoutez (un clic sur le titre de l'article) cette émission, ne serait-ce que pour les citations qui en sont faites.



Dans le cadre d'un semaine sur le snobisme, l'émission consacrée au snobisme de PROUST, ou plus précisément, au snobisme dans la Recherche du temps perdu. Brillamment exposé par Donatien GRAU, enseignant à l'École normale supérieure (ENS) et membre de l'équipe Proust du Centre national de la Recherche scientifique (CNRS).
Même si vous n'êtes pas familiers avec l'œuvre, écoutez (un clic sur le titre de l'article) cette émission, ne serait-ce que pour les citations qui en sont faites.

lundi 15 novembre 2010
L'été de la vie
J. M. COETZEE, L'été de la vie, traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Catherine Lauga du Plessis, Seuil, 2010, titre original Summertime, (320 pages).
Je ne croyais pas, en le plaçant dans ma valise, pouvoir trouver un meilleur livre pour ma semaine à Cayo Largo, moi dont la concentration est, telle l'écoute freudienne, flottante, surtout à la plage. En revanche, difficile d'y apporter son nécessaire de lecture, dictionnaire, cahier de notes, crayons, et impossible d'annoter un livre emprunté à la bibliothèque, qu'on ne veut pas, de surcroît, tacher de crème solaire.Faisons donc confiance à la mémoire.
Je n'ai rien lu de COETZEE depuis une dizaine d'années, depuis Disgrace.
À l'heure où la fiction française souffre encore des pires débordements de « l'auto-fiction », -- sujet d'une récente émission de Répliques, Littérature et vérité, sur France Culture -- il est intéressant de constater comment un auteur anglophone s'y prend pour se raconter tout en se mettant délibérément en fiction. Je le dis d'entrée de jeu : la technique de l'auteur est stupéfiante, et pourtant coule comme de source. Un magnifique travail d'écriture.
Le récit/roman s'ouvre sur une série de fragments de carnets tenus par J. M. COETZEE (l'auteur ou le personnage ?) dans les années 70 dont on saisit mal ce qui les unit. Suivent cinq entretiens menés par un jeune universitaire qui travaille à la biographie du romancier dont on apprend qu'il est décédé (donc le personnage) avec cinq personnes qui ont connu celui-ci dans ces mêmes années. Cinq personnalités très différentes dont la perception de COETZEE l'est également. Le regard de la maîtresse insatisfaite n'est en effet pas le même que celui de la cousine, de la collègue de travail , d'un ancien rival à un poste universitaire ou de la mère d'une de ses élèves. D'autant plus que leurs rapports ont tous été relativement limités dans le temps, d'une part, et, d'autre part, remontent à plusieurs années. Ce qui, au passage, en dit beaucoup sur l'objectivité du travail biographique, mais c'est là un tout autre débat. L'ouvrage se referme sur une nouvelle série de fragments, mais non datés cette fois.
Le chapitre le plus achevé, selon moi, superbe mise en abîme, est celui où l'auteur COETZEE fait lire par son biographe (un personnage fictif) à Margot (peut-être un personnage réel), sa cousine, lors d'une rencontre, la retranscription des enregistrements des conversations qu'ils ont eues, laquelle a été retravaillée « afin que cette prose se lise comme un récit continu de [sa] seule voix » et rédigée à la troisième personne. Ici, la subjectivité du biographe s'ajoute à celle de la cousine, avec en prime le commentaire que celle-ci en fait en cours de lecture. On peut difficilement faire mieux. Ce chapitre m'a paru le plus révélateur de la personnalité du personnage COETZEE; ou plutôt de celle que l'auteur COETZEE souhaiterait nous présenter comme la plus proche de sa propre vérité, de sa propre perception de lui-même. Comme on dit : si non è vero, è bene trovato.
On a beaucoup parlé, à propos du roman de Michel HOUELLEBECQ, La carte et le territoire, de la façon dont il traitait les relations père/fils. Eh bien, quoique je ne vous encourage pas plus que de nécessaire à lire ce dernier roman, lisez L'été de la vie pour voir comment un écrivain s'y prend.
Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et je vous suggère de ne pas ajourner sa lecture à vos prochaines vacances sous les palétuviers.
Présentation de l'éditeur :
Je ne croyais pas, en le plaçant dans ma valise, pouvoir trouver un meilleur livre pour ma semaine à Cayo Largo, moi dont la concentration est, telle l'écoute freudienne, flottante, surtout à la plage. En revanche, difficile d'y apporter son nécessaire de lecture, dictionnaire, cahier de notes, crayons, et impossible d'annoter un livre emprunté à la bibliothèque, qu'on ne veut pas, de surcroît, tacher de crème solaire.Faisons donc confiance à la mémoire.
Je n'ai rien lu de COETZEE depuis une dizaine d'années, depuis Disgrace.
À l'heure où la fiction française souffre encore des pires débordements de « l'auto-fiction », -- sujet d'une récente émission de Répliques, Littérature et vérité, sur France Culture -- il est intéressant de constater comment un auteur anglophone s'y prend pour se raconter tout en se mettant délibérément en fiction. Je le dis d'entrée de jeu : la technique de l'auteur est stupéfiante, et pourtant coule comme de source. Un magnifique travail d'écriture.
Le récit/roman s'ouvre sur une série de fragments de carnets tenus par J. M. COETZEE (l'auteur ou le personnage ?) dans les années 70 dont on saisit mal ce qui les unit. Suivent cinq entretiens menés par un jeune universitaire qui travaille à la biographie du romancier dont on apprend qu'il est décédé (donc le personnage) avec cinq personnes qui ont connu celui-ci dans ces mêmes années. Cinq personnalités très différentes dont la perception de COETZEE l'est également. Le regard de la maîtresse insatisfaite n'est en effet pas le même que celui de la cousine, de la collègue de travail , d'un ancien rival à un poste universitaire ou de la mère d'une de ses élèves. D'autant plus que leurs rapports ont tous été relativement limités dans le temps, d'une part, et, d'autre part, remontent à plusieurs années. Ce qui, au passage, en dit beaucoup sur l'objectivité du travail biographique, mais c'est là un tout autre débat. L'ouvrage se referme sur une nouvelle série de fragments, mais non datés cette fois.
Le chapitre le plus achevé, selon moi, superbe mise en abîme, est celui où l'auteur COETZEE fait lire par son biographe (un personnage fictif) à Margot (peut-être un personnage réel), sa cousine, lors d'une rencontre, la retranscription des enregistrements des conversations qu'ils ont eues, laquelle a été retravaillée « afin que cette prose se lise comme un récit continu de [sa] seule voix » et rédigée à la troisième personne. Ici, la subjectivité du biographe s'ajoute à celle de la cousine, avec en prime le commentaire que celle-ci en fait en cours de lecture. On peut difficilement faire mieux. Ce chapitre m'a paru le plus révélateur de la personnalité du personnage COETZEE; ou plutôt de celle que l'auteur COETZEE souhaiterait nous présenter comme la plus proche de sa propre vérité, de sa propre perception de lui-même. Comme on dit : si non è vero, è bene trovato.
On a beaucoup parlé, à propos du roman de Michel HOUELLEBECQ, La carte et le territoire, de la façon dont il traitait les relations père/fils. Eh bien, quoique je ne vous encourage pas plus que de nécessaire à lire ce dernier roman, lisez L'été de la vie pour voir comment un écrivain s'y prend.
Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et je vous suggère de ne pas ajourner sa lecture à vos prochaines vacances sous les palétuviers.
Présentation de l'éditeur :
« Après Scènes de la vie d'un jeune garçon et Vers l'âge d'homme, voici le troisième volet de l'entreprise autobiographique de Coetzee : il a atteint la trentaine et, de retour au pays natal, partage avec son père vieillissant une maison délabrée dans la banlieue du Cap. Autobiographie fictive puisque l'auteur confie la tâche d'un portrait posthume à un jeune universitaire anglais qui recueille les témoignages de quatre femmes et d'un collègue qui auraient compté pour l'écrivain en gestation dans les années 1970.
Ce quintette de voix laisse entrevoir un homme maladroit, mal à l'aise, brebis galeuse de la famille afrikaner qui peine à ouvrir son coeur. La femme adultère, la danseuse brésilienne, la cousine chérie, l'universitaire et la maîtresse française s'accordent à faire de lui un amant sans chaleur, un amoureux indésirable, un enseignant sans charisme. Ces entretiens sont encadrés de notes et fragments extraits de carnets où l'écrivain s'interroge et se cherche.
Dans ce récit où se mêlent le comique et le ridicule, la mélancolie et le désespoir, Coetzee se livre avec prudence et dévoile peu à peu un coeur en souffrance sous la cuirasse. Il invite une nouvelle fois le lecteur à une superbe méditation sur la condition humaine.»
HOUELLEBECQ post-scriptum
Laure ADLER reçoit Michel HOUELLEBECQ dans le cadre de l'émission Hors champ sur France Culture le 12 novembre dernier. À écouter. Par parenthèse, il est plaisant d'écouter une émission où l'animatrice connaît son sujet et, surtout, le laisse parler; on comprendra que je songe ici à la bavarde dame du matin de la SRC.
L'esprit de ruelle
Benedetta CRAVERI, L’âge de la conversation, Gallimard, collection Tel, Paris, 2005 (680 pages).
On pourrait se demander pourquoi on voudrait lire près de sept cents pages sur la conversation en France entre 1630 et 1789. Si ce n’est quelques universitaires ou francophiles irréductibles (en reste-t-il ?). Les Français ont, comme chacun sait, toujours parlé (« cause toujours… ») ; on sait moins, en revanche, qu’ils n’ont pas toujours su comment le faire. D’aucuns affirment qu’ils ne le savent plus guère, mais c’est un autre débat.
C’est donc l’histoire de cet apprentissage de l’art de la conversation que nous révèle Benedetta CRAVERI dans son captivant ouvrage où nous ferons, sur un siècle et demi, la connaissance de personnalités, pour la plupart, certes, tombées dans l’oubli, mais dont le rôle, même si nous n’en soupçonnons guère l’importance, a été capital dans l’évolution des mœurs et de notre langue.
Nous voici conviés à visiter une remarquable galerie de portraits et introduits dans ce que nous appelons aujourd’hui – en dépit de l’anachronisme – les salons. Car, à l’époque, on reçoit dans la ruelle, laquelle est munie de toutes les commodités de la conversation, chères aux Précieuses et non ce lieu urbain qui l’est si peu.
On verra l’évolution du salon, la durée de vie d’un « genre » de salon couvrant généralement une trentaine d’année, chaque génération y apportant son élément distinctif, sans oublier les rivalités entre salons « montants » et « descendants », ni celles qui opposent ces dames pour obtenir la présence de telle ou telle sommité de l’heure. Madame GEOFFRIN, Madame DUDEFFAND, Madame de TENCIN et Julie de LESPINASSE, chacune connaîtra, avec son public, son heure de gloire, puis son déclin.
Cette évolution ne vise pas que la forme, le fond aussi change. Ainsi, il était inconcevable, et du dernier vulgaire, que l’on parlât de politique chez Madame de RAMBOUILLET, la célèbre ARTHÉNICE, – un des tous premiers salons –, ou même de romans, alors que, un siècle plus tard, toute la fleur des Lumières se pressera chez Madame GEOFFRIN – un des premiers salons bourgeois –, véritable lieu de contre-pouvoir, où les premiers « intellectuels » parleront de liberté et d’égalité et où se feront les élections à l’Académie.
On découvre enfin la double importance de l’institution du salon. Par celle-ci, les femmes assumaient une mission éducatrice tant sur le plan de la langue : c’est principalement grâce au salon que la langue française a connu un si large rayonnement en Europe et, plus tard, en Amérique, notamment dans la diplomatie, alors que sur le plan des mœurs et de la sociabilité, chacun, noble ou bourgeois, voudra atteindre le même niveau de raffinement qu’il y rencontrait.
Commentaire de VOLTAIRE : « Le langage français est de toutes les langues celle qui exprime avec le plus de facilité, de netteté et de délicatesse, tous les objets de la conversation des honnêtes gens ; et par là elle contribue dans toute l’Europe à un des plus grands agréments de la vie. » .
Les temps ont bien changé et je me permettrai un sic transit gloria mundi.
Une anecdote, enfin, pour les lecteurs de Nouvelle-France. La Grande Mademoiselle – il ne s’agit pas d’un éphèbe officiant sur les planches de tel établissement du Village à Montréal, mais de la cousine de Louis, quatorzième du nom – payait de la relégation ses choix politiques du temps de la Fronde. Elle transforma Saint-Fargeau, sinistre château médiéval, en un lieu où chacun voulait être reçu. L’accompagnaient dans son exil quelques jeunes et jolies dames, et SAINT-SIMON écrira sur l’une de celles-ci : « Madame de FRONTENAC n’avait que vingt ans et cherchait par tous les moyens à se débarrasser de son mari. Le comte était “aimable”, “spirituel” et “pas dépourvu d’usage du monde”, mais cela ne suffisait pas pour que la jeune femme l’accueillît dans le lit conjugal et cédât à ces instances. » On aura reconnu dans le mari le bouillant gouverneur du Canada.



On pourrait se demander pourquoi on voudrait lire près de sept cents pages sur la conversation en France entre 1630 et 1789. Si ce n’est quelques universitaires ou francophiles irréductibles (en reste-t-il ?). Les Français ont, comme chacun sait, toujours parlé (« cause toujours… ») ; on sait moins, en revanche, qu’ils n’ont pas toujours su comment le faire. D’aucuns affirment qu’ils ne le savent plus guère, mais c’est un autre débat.
C’est donc l’histoire de cet apprentissage de l’art de la conversation que nous révèle Benedetta CRAVERI dans son captivant ouvrage où nous ferons, sur un siècle et demi, la connaissance de personnalités, pour la plupart, certes, tombées dans l’oubli, mais dont le rôle, même si nous n’en soupçonnons guère l’importance, a été capital dans l’évolution des mœurs et de notre langue.
Nous voici conviés à visiter une remarquable galerie de portraits et introduits dans ce que nous appelons aujourd’hui – en dépit de l’anachronisme – les salons. Car, à l’époque, on reçoit dans la ruelle, laquelle est munie de toutes les commodités de la conversation, chères aux Précieuses et non ce lieu urbain qui l’est si peu.
On verra l’évolution du salon, la durée de vie d’un « genre » de salon couvrant généralement une trentaine d’année, chaque génération y apportant son élément distinctif, sans oublier les rivalités entre salons « montants » et « descendants », ni celles qui opposent ces dames pour obtenir la présence de telle ou telle sommité de l’heure. Madame GEOFFRIN, Madame DUDEFFAND, Madame de TENCIN et Julie de LESPINASSE, chacune connaîtra, avec son public, son heure de gloire, puis son déclin.
Cette évolution ne vise pas que la forme, le fond aussi change. Ainsi, il était inconcevable, et du dernier vulgaire, que l’on parlât de politique chez Madame de RAMBOUILLET, la célèbre ARTHÉNICE, – un des tous premiers salons –, ou même de romans, alors que, un siècle plus tard, toute la fleur des Lumières se pressera chez Madame GEOFFRIN – un des premiers salons bourgeois –, véritable lieu de contre-pouvoir, où les premiers « intellectuels » parleront de liberté et d’égalité et où se feront les élections à l’Académie.
On découvre enfin la double importance de l’institution du salon. Par celle-ci, les femmes assumaient une mission éducatrice tant sur le plan de la langue : c’est principalement grâce au salon que la langue française a connu un si large rayonnement en Europe et, plus tard, en Amérique, notamment dans la diplomatie, alors que sur le plan des mœurs et de la sociabilité, chacun, noble ou bourgeois, voudra atteindre le même niveau de raffinement qu’il y rencontrait.
Commentaire de VOLTAIRE : « Le langage français est de toutes les langues celle qui exprime avec le plus de facilité, de netteté et de délicatesse, tous les objets de la conversation des honnêtes gens ; et par là elle contribue dans toute l’Europe à un des plus grands agréments de la vie. » .
Les temps ont bien changé et je me permettrai un sic transit gloria mundi.
Une anecdote, enfin, pour les lecteurs de Nouvelle-France. La Grande Mademoiselle – il ne s’agit pas d’un éphèbe officiant sur les planches de tel établissement du Village à Montréal, mais de la cousine de Louis, quatorzième du nom – payait de la relégation ses choix politiques du temps de la Fronde. Elle transforma Saint-Fargeau, sinistre château médiéval, en un lieu où chacun voulait être reçu. L’accompagnaient dans son exil quelques jeunes et jolies dames, et SAINT-SIMON écrira sur l’une de celles-ci : « Madame de FRONTENAC n’avait que vingt ans et cherchait par tous les moyens à se débarrasser de son mari. Le comte était “aimable”, “spirituel” et “pas dépourvu d’usage du monde”, mais cela ne suffisait pas pour que la jeune femme l’accueillît dans le lit conjugal et cédât à ces instances. » On aura reconnu dans le mari le bouillant gouverneur du Canada.

samedi 13 novembre 2010
Proust à la plage
J'ai passé la dernière semaine d'octobre sur l'île de Cayo Largo avec quelques amis. Plage et mer, une coupure totale du monde, ni journaux, ni télé. J'ai donc beaucoup lu. Mais je n'ai pas fait que lire : sous mon palapa, j'ai fini d'écouter la série de treize podcasts du Collège de France retransmission des cours d'Antoine COMPAGNON intitulés Morales de Proust. Si vous visitez le site, armez vous de patience, il est très français, c'est à dire assez user hostile, car conçu par des gens qui, à l'évidence, ne se servent pas beaucoup d'un ordinateur. Mieux vaut passer par iTunes.
Quoiqu'il en soit, j'ai beaucoup aimé ces conférences qui ont jeté un nouvel éclairage sur certains thèmes de la Recherche du Temps perdu et, bien entendu, m'ont donné le goût de relire certains passages de l'œuvre, dont la très célèbre exécution du baron de CHARLUS chez les VERDURIN dans le roman La prisonnière.
J'ai même appris un nouveau mot lequel, je n'en doute pas, me permettra de briller dans les dîners et les salons : épicaricacie. Nul dictionnaire ne vous en donnera la définition, formé de trois mots grecs (autour+joie+mal) : il s'agit de la « joie mauvaise » que l'on éprouve, par exemple, devant le malheur qui frappe autrui, et qui occasionne un ricanement fort peu charitable. Tel pipole voit quelque contrariété rapportée par les médias et sa gloire écornée et c'est le « il l'a bien mérité » populaire.
Dommage cependant que ce terme soit trop long pour me servir au Scrabble. Vous vous en réjouissez pensant in petto « quel cuistre » : voilà mon second exemple d'épicaricacie.
Quoiqu'il en soit, j'ai beaucoup aimé ces conférences qui ont jeté un nouvel éclairage sur certains thèmes de la Recherche du Temps perdu et, bien entendu, m'ont donné le goût de relire certains passages de l'œuvre, dont la très célèbre exécution du baron de CHARLUS chez les VERDURIN dans le roman La prisonnière.
J'ai même appris un nouveau mot lequel, je n'en doute pas, me permettra de briller dans les dîners et les salons : épicaricacie. Nul dictionnaire ne vous en donnera la définition, formé de trois mots grecs (autour+joie+mal) : il s'agit de la « joie mauvaise » que l'on éprouve, par exemple, devant le malheur qui frappe autrui, et qui occasionne un ricanement fort peu charitable. Tel pipole voit quelque contrariété rapportée par les médias et sa gloire écornée et c'est le « il l'a bien mérité » populaire.
Dommage cependant que ce terme soit trop long pour me servir au Scrabble. Vous vous en réjouissez pensant in petto « quel cuistre » : voilà mon second exemple d'épicaricacie.
La carte et le territoire II
Michel HOUELLEBECQ, La carte et le territoire, Flammarion, Paris, septembre 2010 (428 pages).
Trêve d'atermoiements, je ne parlerai pas, ou seulement un peu, du HOUELLEBECQ : à quoi bon en rajouter au concert d'éloges ou aux diatribes ?
Au rang des « contre », j'ai bien aimé l'éreintement de Pierre JOURDE You Know What? Houellebecq is the hero dans son blog du Nouvel Observateur. Du côté des « pour », je n'ai pas beaucoup aimé la quasi générale glose sur la quatrième de couverture. Et à quand, de part et d'autre, un véritable commentaire sur le style, sur l'écriture ?
Si je tiens encore l'auteur pour une sorte de BALZAC contemporain, ce roman m'a semblé assez moyen. Les deux premières parties tiennent la route, pour peu qu'on ne soit pas allergiques aux descriptions détaillées -- telles celle du Samsung ZRT-AV2 (page 162) ou sa dissertation sur la langue de modes d'emplois (page 163) -- dont voici un exemple :
Ma conclusion : bon divertissement, mais comme les bons livres ne manquent pas, je songe ici au dernier COETZEE, on ne perdra rien à faire l'impasse sur La carte et le territoire.
Trêve d'atermoiements, je ne parlerai pas, ou seulement un peu, du HOUELLEBECQ : à quoi bon en rajouter au concert d'éloges ou aux diatribes ?
Au rang des « contre », j'ai bien aimé l'éreintement de Pierre JOURDE You Know What? Houellebecq is the hero dans son blog du Nouvel Observateur. Du côté des « pour », je n'ai pas beaucoup aimé la quasi générale glose sur la quatrième de couverture. Et à quand, de part et d'autre, un véritable commentaire sur le style, sur l'écriture ?
Si je tiens encore l'auteur pour une sorte de BALZAC contemporain, ce roman m'a semblé assez moyen. Les deux premières parties tiennent la route, pour peu qu'on ne soit pas allergiques aux descriptions détaillées -- telles celle du Samsung ZRT-AV2 (page 162) ou sa dissertation sur la langue de modes d'emplois (page 163) -- dont voici un exemple :
« Le Sushi Warehouse de Roissy 2 proposait un choix exceptionnel d'eaux minérales norvégiennes. Jed se décida pour la Husqvarna, plutôt une eau du centre de la Norvège, qui pétillait avec discrétion. Elle était extrêmement pure -- quoique, en réalité, pas davantage que les autres. Toutes ces eaux minérales ne se distinguaient que par un pétillement, une texture en bouche légèrement différents; aucune d'entre elles n'était si peu que soit salée, ni ferrugineuse; le point commun des eaux minérales norvégiennes semblait être la modération. Des hédonistes subtils, ces Norvégiens, se dit Jed en payant sa Husqvarna; il était agréable, se dit-il encore, qu'il puisse exister tant de formes différentes de pureté. »On s'amusera peut-être d'entendre Frédéric BEIGBEDER, qualifié de SARTRE des années 2010, entonner le Blues du businessman des PLAMONDON/BERGER (page 77). On appréciera sans doute la construction du récit de la vie et de la carrière du personnage principal, Jed MARTIN. On sourira vraisemblablement du commentaire de la société médiatique et libérale. Mais quid de la troisième partie, sorte de polar, où HOUELLEBECQ se voit assassiné et son corps dispersé telle une toile de Jakson POLLOCK ? Et de la conclusion téléphonée ?
Ma conclusion : bon divertissement, mais comme les bons livres ne manquent pas, je songe ici au dernier COETZEE, on ne perdra rien à faire l'impasse sur La carte et le territoire.
vendredi 12 novembre 2010
De retour
Régis DEBRAY, Éloge des frontières, Gallimard, Paris 2010 (pas encore disponible au Canada).
Une semaine à la mer, propice certes à la lecture mais pas à l'écriture, avec une saine coupure médiatique, puis, au retour, une brève mais contrariante révolution interne m'auront tenu éloigné de mon clavier. J'ai manqué l'émotion médiatique de l'attribution du Goncourt à HOUELLEBECQ, pourtant unanimement prévue par les mêmes médias, alors que mon billet sur icelui est encore, si j'ose dire, en souffrance. Au passage ce matin, cette entrevue de Régis DEBRAY sur son nouvel essai.
À venir, outre l'article sur La carte et le territoire, le récent L'été de la vie de J. M. COETZEE et Magique étude du Bonheur de Vincent CESPEDES.
Les Matins- Régis Debray
envoyé par franceculture. - L'actualité du moment en vidéo.
Une semaine à la mer, propice certes à la lecture mais pas à l'écriture, avec une saine coupure médiatique, puis, au retour, une brève mais contrariante révolution interne m'auront tenu éloigné de mon clavier. J'ai manqué l'émotion médiatique de l'attribution du Goncourt à HOUELLEBECQ, pourtant unanimement prévue par les mêmes médias, alors que mon billet sur icelui est encore, si j'ose dire, en souffrance. Au passage ce matin, cette entrevue de Régis DEBRAY sur son nouvel essai.
À venir, outre l'article sur La carte et le territoire, le récent L'été de la vie de J. M. COETZEE et Magique étude du Bonheur de Vincent CESPEDES.
Les Matins- Régis Debray
envoyé par franceculture. - L'actualité du moment en vidéo.
S'abonner à :
Messages (Atom)