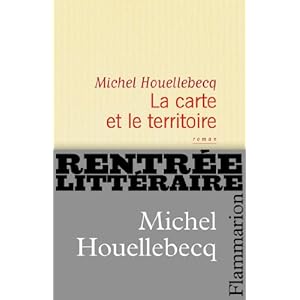« Soigner, c'est-à-dire soigner jusqu’au bout, c’est traverser un champ dont on ne connaît ni l’état du sol, ni la nature des herbes. C’est accepter les fleurs d’orties, la gadoue putride, les entorses et aussi les odeurs fraîches, l’ombre piquetée de soleil d’un arbre solitaire. C’est fatigant et dur. On se fait mal au dos, on en a marre, on voudrait que ça se termine vite, on se le reproche, on essaie de sourire et de ne pas se presser, et on pleure en cachette après l’avoir entendu appeler ce nom d’enfant que lui seul utilisait. »
Je vais refermer l'année 2010 sur l'autre livre de la collection L'un et l'autre que j'ai lu il y a maintenant quelques semaines. Ne craignez rien, lecteur, il n'y aura pas de bilan, ni de best of. Peut-être quelques résolutions, dont mieux lire, j'entends aller vers des livres essentiels, me tenir à l'écart de l'agitation provoquée par la réclame, laquelle, justement, réclame toujours beaucoup de temps. Toutes ces Pléiades acquises au fil des années « pour la retraite ». J'y suis. Écrire ? vaste projet, tant écrivent déjà.
Revenons à Soigner. Il s'agit d'un récit plus personnel, plus intime aussi, que ceux que l'on trouve dans la collection; au point que l'on peut -- certains critiques l'ont fait -- se demander qui est « l'autre » ici. Le grand-père ? Assurément. Mais, pour moi, l'autre serait la maladie, celle qui change tout, celle qui marque un avant et un après, celle qui nous fait autre à nous même.
Pendant que je lisais ces quelques pages, fort touchantes, mais sans pathétique, une amie se voyait confrontée au plus près à la maladie de sa mère. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle se voyait révéler un cancer, déjà fort avancé. Que faire : infliger d'autres soins pénibles à cette vieille dame, au prix de quelle douleur, et à quelle fin ? Le temps a décidé, en quelque sorte, pour l'une et l'autre. La mort est venue. Et maintenant mon amie se retrouve bien seule, qui prenait jour après jour soin de sa mère, dont la vie était réglée sur celle-ci : qui en somme, était devenue la mère de sa mère. Mais sans espoir. Voilà, mon amie a perdu son « autre ». Il lui reste bien des questions, et nul n'a la moindre réponse pour l'éclairer. Sans doute le temps deviendra-t-il cet autre, oubli et mémoire opéreront la métamorphose qui, à défaut de réponse lui donneront un peu de paix. Souhaitons-le.
Comment soigner ?
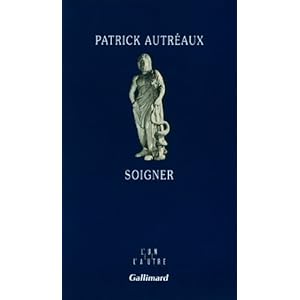

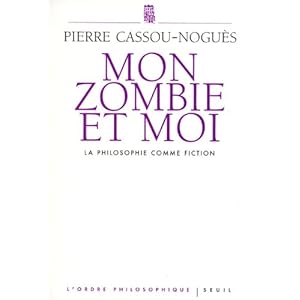



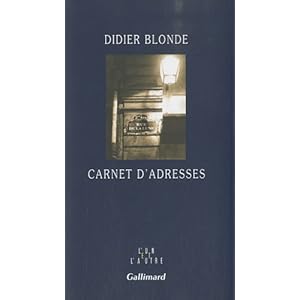
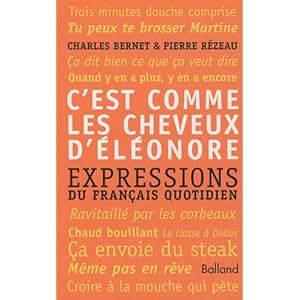

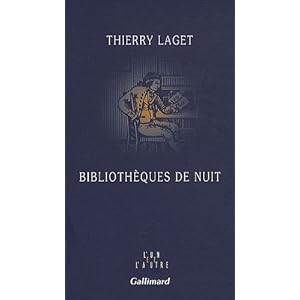
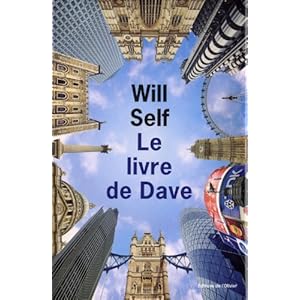



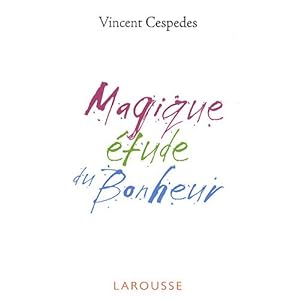

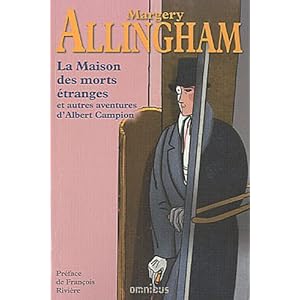 O
O