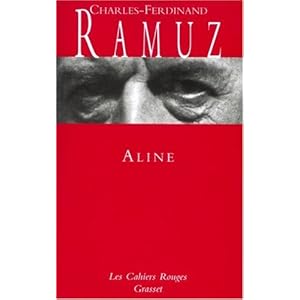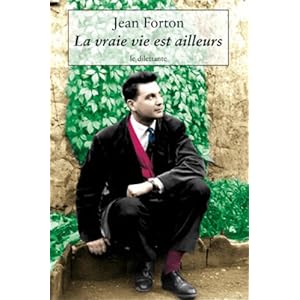Charles-Ferdinand RAMUZ, Aline, Les Cahiers Rouges - Grasset, avril 2002, éd. originale 1905 (144 pages) -- support papier + électronique.
La campagne dans le canton de Vaud, en Suisse, au début du XXe siècle, c'est en 1905 peut-être, mais ça aurait bien pu être en 1705 ou en 1505. C'est ainsi : les homme sont les hommes, et forts, les femmes parlent et sont les choses des hommes, les saisons vont et reviennent, comme le service à l'église le dimanche, les semailles et les moissons.Quand un homme voit une jeune fille sur son chemin, et qu'il est le Julien Damon, et qu'elle est l'Aline, la fille de la veuve Henriette, il peut lui parler. Et s'il lui parle, c'est qu'il veut la voir. La voir et l'avoir. Même qu'il lui donne de belles boucles d'oreilles, mais qu'elle ne pourra porter, vu que sa mère, à elle, ne comprendrait pas.
C'était si bon l'amour pour elle : « Quand on aime, le temps où on ne s'est pas aimé est comme une belle robe qu'on n'a pas mise. » Elle, l'Aline, pour le Julien elle était un peu comme un nouveau jouet, mais dont il se lasse bientôt. « Il était pareil à un homme qui s'est assis à une table servie et se lève quand il n'a plus faim. Il se lève et on voit qu'il va s'en aller et qu'on ne peut plus le retenir, parce que l'amour qu'il avait était une faim qui passe, comme la faim passe. »
C'est ainsi depuis toujours.
Une nuit, il ne vint pas. « D'abord elle crut seulement que Julien était en retard. On ne fait pas toujours ce qu'on veut; voilà ce qu'elle se disait. Mais, à mesure que le temps passait, elle devenait plus agitée, à cause de ses imaginations. On pense à la maladie, on pense à la mort : elle ne pensait pas à la seule chose véritable, qui est la cruauté des hommes. » D'autant plus que l'Aline, elle n'était pas bonne à marier, elle n'avait pas de biens la fille de la veuve Henriette.
C'est ainsi depuis toujours.
Et puis, peu après : « Il faisait un petit temps gris un peu frais, et il soufflait un rien de bise. Le ciel avait des nuages blancs tout ronds qui se touchaient comme les pavés devant les écuries. Les vaches dans les champs branlaient leurs sonnailles de tous les côtés. » Elle lui montra son ventre, c'est vrai; « fiche moi le camp », dit le Julien à l'Aline. C'est dire que ce n'était pas une bonne fille, maintenant tout le village savait.« Les choses viennent, on ne peut pas les empêcher. » Julien, lui, est en bonne santé et content de vivre, les gens disaient : « Celui-là, il a eu au moins une femme qui l'a aimée. » Mais ne disaient rien d'autre. Le malheur, un vrai malheur, finira bien par arriver.
C'est ainsi depuis toujours.
Cela finira bien au cimetière : « C'est un endroit plein d'oiseaux, de fleurs et d'ombre. Il y a un vieux mur qui croule pierre à pierre parmi les orties et les coquelicots. Des ifs et des saules pleureurs ombragent les tombes aux noms effacés; les couronnes de verre, suspendues aux croix de bois, tintent quand il fait du vent. Il y a aussi des tombes oubliées, pleines de mousse et de pervenches. Les fauvettes, les mésanges qui sont farouches et les chardonnerets qui sont verts et gris, avec un petit peu de rouge, nichent dans les branches. Et les marguerites, l'esparcette, la sauge, le trèfle, fleurs des champs semées là par la brise, s'ouvrent parmi les hautes graminées. »
Il y a les hommes, il y a les fauvettes, les mésanges qui sont farouches. C'est pourquoi on lit Ramuz, pas pour les cinquante nuances de gris des pavés de saison, pour les fauvettes, les mésanges qui sont farouches.
C'est ainsi depuis toujours.
Présentation
« Une jeune paysanne est attirée par Julien Damon, le coq du village. Son amour grandit, mais il s'éteint vite chez Julien. Aline (1905) est un chef-d'oeuvre de jeunesse, une "symphonie pastorale" où Ramuz décrit avec subtilité la passion et le revirement des cœurs. »