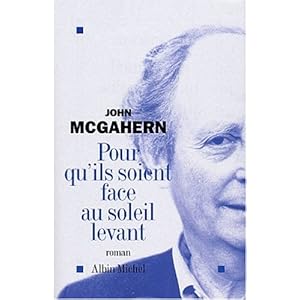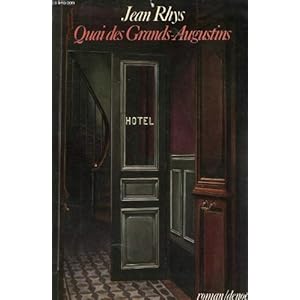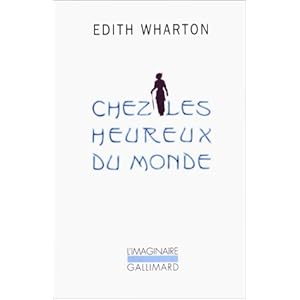Guillaume de THIEULLOY, Le pape et le roi - Anagni - 7 septembre 1303, Gallimard, Les journées qui ont fait la France, Paris, mars 2010 (268 pages).
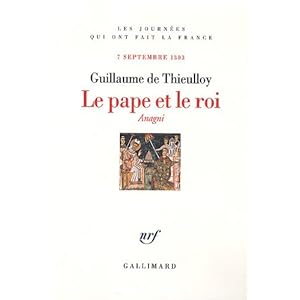 J'ai quelque scrupule à vous entretenir de l'essai de Guillaume de THIEULLOY tant je redoute de susciter une vague d'émotion chez mon vaste public, lequel, par effet d'entraînement néfaste, se précipitera toute affaire cessante en foule dans toutes les librairies du Royaume (car c'est ainsi, de par le vœu de notre Intrépide Leader Fédéral, que devrait désigné notre pays) en quête du livre à lire cet été. Le récit de l'attentat commis par un ministre du roi de France Philippe IV dit le Bel contre le pape Boniface VIII. Pour ceux qui ont quelque mémoire, et déjà bien de l'âge, il s'agit du même souverain que celui qui, du fait de l'interdiction de l'ordre des Templiers et de la persécution des membres de cet ordre, sera à l'origine de la malédiction qui frappera sa lignée et dont on trouve le narré dans un roman historique célébrissime de Maurice Druon, Les Rois maudits. Parlant le jargon de la télévision, nous tenons, avec Le pape et le roi, la prequel de cette histoire. Avis aux scénaristes.
J'ai quelque scrupule à vous entretenir de l'essai de Guillaume de THIEULLOY tant je redoute de susciter une vague d'émotion chez mon vaste public, lequel, par effet d'entraînement néfaste, se précipitera toute affaire cessante en foule dans toutes les librairies du Royaume (car c'est ainsi, de par le vœu de notre Intrépide Leader Fédéral, que devrait désigné notre pays) en quête du livre à lire cet été. Le récit de l'attentat commis par un ministre du roi de France Philippe IV dit le Bel contre le pape Boniface VIII. Pour ceux qui ont quelque mémoire, et déjà bien de l'âge, il s'agit du même souverain que celui qui, du fait de l'interdiction de l'ordre des Templiers et de la persécution des membres de cet ordre, sera à l'origine de la malédiction qui frappera sa lignée et dont on trouve le narré dans un roman historique célébrissime de Maurice Druon, Les Rois maudits. Parlant le jargon de la télévision, nous tenons, avec Le pape et le roi, la prequel de cette histoire. Avis aux scénaristes.Mais s'il ne s'agit pas en l'instance d'un roman, je vous mets au défi de trouver récit plus captivant de cet événement dont nous avons, il est vrai, quelque difficulté à apprécier les conséquences. Un fonctionnaire lève la main sur le pape il y a sept cents ans : et après ? Pour résumer à l'extrême, c'est cette gifle -- en réalité, il n'y a pas eu de gifle, mais comme on dit si bien en Italien, si non è vero, è ben trovato, la réalité est bien plus intéressante, surtout pour les marchands, si elle est bien maquillée -- qui est à l'origine de la séparation de l'Église et de l'État. Gifle qui aura été le point culminant d'une longue querelle de pouvoir, où se mêlent intrigues politiques et religieuses, entre le politique et le religieux.
Rappelons que, deux siècles plus tôt, en 1077, le pape Grégoire VII avait eu raison d'Henri IV, l'empereur du Saint Empire romain germanique (héritier de Charlemagne et de l'Empire romain). Depuis, certes, la maison de France -- les Capétiens -- avait réussi à s'émanciper de la tutelle féodale de l'Empire, mais pas encore des prétentions du Saint-Siège, lequel revendiquait la suprématie et spirituelle et temporelle.
Prétentions qui nous semblent sans conteste singulières.
Par comparaison, il suffit d'imaginer que la chrétienté avait une structure politico-religieuse semblable à celle du monde musulman, où le politique procède du religieux.
Si, dans les premiers temps, on appliquait le « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César » évangélique, cette parole du Christ a été réinterprétée une fois que le christianisme fut devenue l'unique religion de l'Empire. La chrétienté -- nulle différence terminologique alors entre l'assemblée des croyants et l'Église -- était l'incarnation du corps du Christ, et son vicaire sur terre, le pape, la tête de celle-ci. Ceci constituait un principe fondamental de droit naturel, car un corps ne peut avoir deux têtes, sauf à être un monstre, ce que Dieu ne saurait avoir créé, ni permettre.
Une autre image complétait la première : celle des deux glaives : le premier, spirituel, était tenu par l'Église, le second, temporel pour l'Église, au titre d'une délégation à l'État (même si nous sommes conscients de l'anachronisme de cette appellation). Boniface ira même jusqu'à s'écrier : « je suis l'Empereur, je suis César » !
Car, au nom de Dieu, le pape faisait l'Empereur, lequel, ne l'oublions pas était élu. Si celui-ci venait à s'écarter du droit chemin, le pape pouvait, par l'excommunication, le destituer (en libérant ses vassaux et sujets de leur serment). Il en allait autrement pour la France où, depuis Clovis et son sacre, la dynastie régnante prétendait tenir son élection directement de Dieu, sans nécessité de médiation papale. Tant que les titulaires de l'autorité royale n'ont pas été assurés de leur trône, ils n'auraient pas osé s'attaquer à la suprématie du Saint-Siège, négociant avec celui-ci des accommodements plus ou moins durables. Ce n'était plus le cas des Capétiens, maintenant bien installés sur le trône, et, depuis la victoire de Bouvines, et Saint Louis, bien installés sur leur trône. La revendication papale à la théocratie ne pouvait, à terme, que heurter la volonté du roi de France d'être « maître chez lui » et, de surcroît, un sentiment national en train de naître.
Voilà en gros pour ce que l'auteur appelle le « problème théologico-politique ».
Je vous passe les sources et les péripéties de la querelle entre Philippe et Boniface, lesquelles sont expliquées dans un style d'une grande clarté et l'on complimentera l'auteur pour sa présentation, si j'ose la comparaison, en flash-back, et très bien documentée (mais sans recours abusif aux notes infrapaginales). Sachez seulement qu'il y aura des accusations d'hérésie (un crime pire que l’homicide, car offense à Dieu) portées par Philippe contre le pape, et de sodomie, et de simonie, et d'usurpation du trône de Pierre, et d'assassinat de son prédécesseur (la liste resservira plus tard pour les Templiers) et des menaces d'excommunication et de destitution fulminées par le pape contre le roi.
Et d'un côté comme de l'autre, les banquiers (le principal agent de Philippe s'appelle Musciato Guidi, dit Mouche) s'activeront... l'argent, toujours l'argent.
Le rédacteur législatif que je fus ne peut s'empêcher de citer le texte (légèrement modernisé) de l'ordre de mission donné par Philippe à son émissaire Guillaume de Nogaret :
« Nous conférons [à Nogaret et à ses compagnons] plein et libre pouvoir de traiter pour nous et en notre nom avec toutes espèces de personnes, nobles, ecclésiastiques ou séculières, de quelque rang éminent ou condition qu'elles soient, relativement à des alliances, confédérations et amitiés entre nous et ces personnes, par des subventions, subsides et aides à établir mutuellement; poursuivre les traités en question, les porter à terme et en garantir fermement la validité; établir et confirmer les susdites confédérations, alliances, amitiés, promettre toute espèce de subventions, subsides et aides, faire tout ce qui paraîtra opportun relativement à ce qui précède. »
Je persiste : un authentique best-seller...
Présentation de l'éditeur :
« Ce samedi, à l'aube, la paisible ville d'Anagni, où le pape Boniface VIII séjourne dans son palais pontifical, est investie par des centaines d'hommes armés, conduits par un émissaire de Philippe le Bel. Ils ont ordre de se saisir de la personne du souverain pontife et de lui signifier sa mise en accusation pour hérésie. Violences, pillages, des morts, des blessés, et voici le vicaire du Christ, assis face à ses agresseurs, coiffé de la tiare et serrant dans ses mains un crucifix taillé dans le bois du Golgotha. Bientôt le peuple s'émeut, se révolte et fait libérer le pape captif.
» Que signifie la présence du confident d'un roi de France à la tête d'une meute de soudards ? Que cherche Philippe le Bel ? Pourquoi ce procès en hérésie intenté au chef de la chrétienté ? Comment le pape et le roi en sont-ils venus à cette extrémité ? Telles sont les questions que tente d'élucider cet ouvrage. Il reconstitue les termes et les enjeux d'une controverse inséparablement théologique et politique, brosse le portrait des deux figures exceptionnelles qui dominent ce théâtre éclatant, interroge les théories et les arguments mobilisés par les deux camps, avant de décrire le cheminement qui a conduit fatalement à cette guerre des principes.
» Le pape entendait exercer une autorité directe sur les princes temporels. Le roi affirmait détenir son pouvoir de Dieu seul. C'est cette autonomie sacrale qui donnera plus tard sa physionomie à la nation France. L'épreuve d'Anagni porte déjà en germe ce qu'on appellera plus tard le gallicanisme. C'est alors également que sont réunis pour la première fois les États généraux du royaume. La France entre dans une nouvelle ère. »