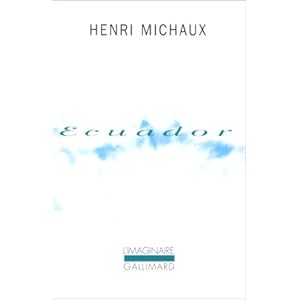André MAJOR, Le sourire d'Anton ou l'adieu au roman (carnets 1975-1992), édition originale en 2001, et 2012 (185 pages); L'esprit vagabond (carnets 1993-1994), édition originale en 2007, et 2012 (325 pages); Prendre le large (carnets 1995-2000), octobre 2012; Boréal, 2012 (227 pages).
Première partie
Enlevant voyage que celui fait, le temps d'une saison, en compagnie d'André Major, et couvrant un bon quart de siècle, de 1975 à 2000, de la vie littéraire de cet écrivain, dont le rapport à l'écriture semble toujours ardu -- n'a-t-il pas délaissé le genre romanesque pour le carnet ? Avec lui, j'ai pris le large, en littérature -- ces carnets sont de ces livres à livres que j'affectionne, tout comme j'aime les allers-retours entre des hier et des aujourd'hui révolus, mais que la lecture actualise sans cesse. Au temps de l'écriture succède celui, successif ou croisé, de la lecture faite d'une part par l'auteur, tant au moment de l'édition originale qu'à celui des nouvelles éditions, avec retouches et repentirs, et, d'autre part, par les lecteurs, laquelle constitue aussi une forme d'écriture dont le résultat, l’œuvre, perpétuellement inachevée, fait corps avec notre vie. Écrire la vie, lire la vie, vivre la vie.
Au temps de l'écriture succède celui, successif ou croisé, de la lecture faite d'une part par l'auteur, tant au moment de l'édition originale qu'à celui des nouvelles éditions, avec retouches et repentirs, et, d'autre part, par les lecteurs, laquelle constitue aussi une forme d'écriture dont le résultat, l’œuvre, perpétuellement inachevée, fait corps avec notre vie. Écrire la vie, lire la vie, vivre la vie. Œuvre que j'ai abordée en quelque sorte à rebours en commençant par le recueil le plus récent, poursuivant avec le premier et concluant avec le médian, le plus important, pour le volume du moins, avec ses 325 pages pour seulement deux ans.
Œuvre que j'ai abordée en quelque sorte à rebours en commençant par le recueil le plus récent, poursuivant avec le premier et concluant avec le médian, le plus important, pour le volume du moins, avec ses 325 pages pour seulement deux ans.  Prendre le large, titre du dernier opus, expression qui revient assez souvent dans les trois livres, décrit sans doute le mieux l'esprit qui anime l'auteur dans la rédaction (et, in fine, dans la relecture/révision/réécriture) des carnets : que ce soit vis à vis son activité professionnelle (il a longtemps travaillé à Radio-Canada comme réalisateur) ou, ce qui pourrait surprendre, vis à vis la création littéraire ou, pour être plus précis, romanesque. L'une et l'autre sont pour lui sources d'une profonde réflexion -- irais-je jusqu'à suggérer l'expression d'un mal de vivre ? qu'il transcrit d'abord assez sommairement, puis articule de mieux en mieux, face à ce qu'il décrit -- la vivant très mal -- comme une inexorable désaffection de la culture, voire du savoir, humaniste. Réflexion nourrie par une excellente pratique de la littérature -- ce qui en fait pour moi un des meilleurs livres à livres que j'ai lus depuis longtemps, et des plus précieux : j'aurai grâce à Major de quoi lire pour des années encore, pour tout ce qu'il m'en reste j'en suis certain, voire, par sa médiation, de quoi relire, car j'aime à confronter ma lecture à celle d'un lecteur si raffiné et subtil.
Prendre le large, titre du dernier opus, expression qui revient assez souvent dans les trois livres, décrit sans doute le mieux l'esprit qui anime l'auteur dans la rédaction (et, in fine, dans la relecture/révision/réécriture) des carnets : que ce soit vis à vis son activité professionnelle (il a longtemps travaillé à Radio-Canada comme réalisateur) ou, ce qui pourrait surprendre, vis à vis la création littéraire ou, pour être plus précis, romanesque. L'une et l'autre sont pour lui sources d'une profonde réflexion -- irais-je jusqu'à suggérer l'expression d'un mal de vivre ? qu'il transcrit d'abord assez sommairement, puis articule de mieux en mieux, face à ce qu'il décrit -- la vivant très mal -- comme une inexorable désaffection de la culture, voire du savoir, humaniste. Réflexion nourrie par une excellente pratique de la littérature -- ce qui en fait pour moi un des meilleurs livres à livres que j'ai lus depuis longtemps, et des plus précieux : j'aurai grâce à Major de quoi lire pour des années encore, pour tout ce qu'il m'en reste j'en suis certain, voire, par sa médiation, de quoi relire, car j'aime à confronter ma lecture à celle d'un lecteur si raffiné et subtil.Le lecteur qui se lancera dans la trilogie des carnets remarquera que, comme dans tout domaine d'activité, l'aisance croît avec la pratique : un peu corseté au début, l'auteur tâtonne comme si, fuyant le roman, il se cherchait encore, non pas tant un style qu'une manière d'écrire sa vie sans tomber dans le piège du narcissisme, et nous offre, ainsi, du bien écrit, du très écrit. Cela dure heureusement fort peu, et bientôt, il apprend à se faire confiance, et à sa plume (en l'espèce, si je comprends bien, un dactylo). Laquelle, assez tôt, sait être polémique, s'agissant notamment de langue -- notre langue -- et du milieu dit culturel :
« Faute de parvenir à réaliser notre désir d'autonomie, nous choisissons la voie détournée et suicidaire d'un nationalisme culturel réduit à sa plus simple expression : l'affirmation d'une souveraineté linguistique. Mais comme ce nationalisme, plus soucieux de revanches symboliques que de cohérence intellectuelle, fait bon ménage avec un populisme agressif, la langue qui nous sert d'identité collective souffre d'une gangrène que nos québécisants considèrent, eux, comme le signe d'une vitalité unique dans le monde francophone. [...] nous sommes également les promoteurs d'une contamination de la langue écrite par la langue parlée, sacrifiant au passage l'élégance et les nuances de la première qui s'en trouve non seulement appauvrie mais condamnée à l'approximation » 22 février 1989.
« J'accepte la bâtardise de notre langue écrite et parlée -- mais de guerre lasse -- comme un fait aussi inévitable que la neige en hiver. Mais certainement pas d'y voir la manifestation d'une quelconque originalité, encore moins la preuve de notre vitalité culturelle » 16 mars 1996.
 |
| André Major |