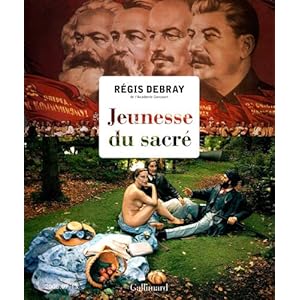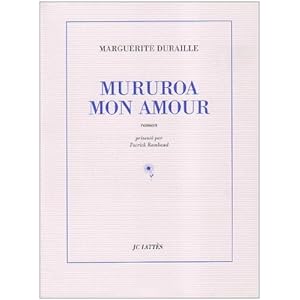Écoutez cette chronique de Philippe Meyer, le toutologue de France Culture.
jeudi 31 mai 2012
samedi 26 mai 2012
Jeunesse du sacré
Régis DEBRAY, Jeunesse du sacré, Gallimard, Paris, janvier 2012 (224 pages).
Un peu de retard, ne vous inquiétez pas chers lecteurs, dans mes billets, pour cause d'une petite escapade maritime dans le Maine à l'invitation d'un ami (qu'il soit remercié), la déambulation sur la plage m'ayant libéré de mon clavier. Longues promenades, mais aussi beaucoup de lecture et d'écoute de podcasts. Lecture fort sérieuse, dont cet essai de Régis DEBRAY sur le sacré, où l'image illustre très bien le propos de l'auteur, propos qui s'inscrit dans la foulée de ses essais précédents Dieu, un itinéraire et Le feu sacré - Fonctions du religieux et aussi de son Journal d'un candide en Terre sainte. Quoiqu'il faille se garder de confondre sacré et religieux. Car si l'Occident, en général (les États-Unis étant la plus criante exception), se veut laïque, réservant le domaine du religieux à la sphère privée et la société civile affichant face à celui-ci une certaine neutralité, nul, selon l'auteur, n'échappe au sacré, dont les exemples ne se limitent pas au seul Occident. Exemple tiré de la Révolution française : les révolutionnaires n'ont pas plus tôt détruit les tombes royales de Saint-Denis qu'il ont sacralisé, sous le couvert de la loi, les arbres de la liberté, puis le culte de la Raison. Simplifions : le sacré est le liant indispensable à toute société -- aussi essentiel à celle-ci que la frontière : pas de « nous » possible, s'il n'y a pas un « eux ». Raisonnement que l'on pourrait peut-être appliquer au Québec, ce pays qui n'arrive pas à se faire, où l'on peine à déterminer ce qui constitue le « nous », et ce qui est sacré pour celui-ci.
Au vrai, je ne me lasse pas du style de Debray, sans doute pour ce côté flamboyant à la Malraux, il serait, si j'ose dire, pour l'essai ce que le flamboyant est au gothique. C'est pourquoi je conseillerais au lecteur, dont les moments de lecture sont comptés, mais que la question intéresse d'aborder Debray par le présent ouvrage, quitte à approfondir par la suite avec les autres titres mentionnés ci-dessus.
La quatrième de couverture vous donnera un aperçu de ce style si particulier.
Quatrième de couverture :
« Enlever au sacré sa majuscule et ses mystères pour lui remettre les pieds sur terre : c'est le propos de cette enquête où l’œil et l'esprit s'interpellent gaiement.
L’œil, pour scruter tout autour du monde les angles morts des études savantes : ces lieux, naturels ou construits, modestes ou grandioses -- montagnes et sépultures, dépôts d'archives et enceintes de justice --, que l'on s'accorde à retirer de la circulation.
L'esprit, pour se défaire de vieux clichés, qui confondent le sacré avec le divin ou l'opposent au profane de façon irrémédiable. Comme si chaque époque ne faisait pas du sacré avec du prosaïque.
Ce qui légitime le sacrifice et interdit le sacrilège procède d'une fabrique purement humaine où l'ouvrage est sans cesse remis sur le métier. Il n'y a pas de sacré pour toujours, mais il y a toujours du sacré dans une société au développement durable. À preuve nos principes intouchables, propos intolérables et monstres sacrés.
Et voilà que notre modernité hypertechnique redonne à cet immémorial une nouvelle jeunesse -- quitte à le faire glisser de l'histoire à la nature.
Tant il est vrai que la pulsion de survie n'a pas de date de péremption. »
Présentation de l'éditeur :
« Agile et d’accès aisé, ce livre novateur dans sa facture ne juxtapose pas un texte et des images (environ deux cents) mais les fait dialoguer. Le texte explique et l’image questionne l’explication. On ne peut lire sans regarder ni regarder sans lire. Le sacré est un sujet crucial et d’actualité. Dans le monde d’abord, où s’enflamment guerres de religion et "chocs des civilisations", autour d’enjeux insurmontables parce que sacralisés. En France ensuite, où chaque communauté brandit son sacré à elle (génocide, viande halal, embryon, euthanasie…) pour se replier sur son périmètre et s’opposer à ses voisines. Tandis que notre pays, obscurément, court après des valeurs fédératrices et rassembleuses. Jeunesse du sacré s’adresse à ceux qui croient au ciel comme aux autres. Aux lycéens, parce que c’est un album avec des images insolites ou cocasses. Aux enseignants, parce que c’est un mémento qui résume en termes simples des études érudites et lance des ponts entre disciplines : géographie, histoire, beaux-arts, littérature, philosophie… A l’honnête homme, parce que c’est un mode d’emploi sans jargon ni appareil de notes, qui l’aidera à faire le net dans sa tête et sa vie : "Au fond qu’est-ce qu’il y a de sacré aujourd’hui pour moi ?" Jeunesse du sacré est un livre utile pour nous débarrasser de fausses idées reçues, quitte à fâcher un peu en secouant des certitudes - la première de toutes étant celle qui confond sacré et religieux : Auschwitz n’est pas une synagogue, ni la flamme du Soldat inconnu un sanctuaire chrétien… Utile également à remettre en perspective les événements du jour dans les longues durées. On pourra en somme faire servir ce vade mecum illustré aussi bien à l’instruction civique qu’à des méditations personnelles et à l’histoire sociale du présent, y compris dans ses aspects les plus ordinaires. »
jeudi 24 mai 2012
Sideway Rain
Guilherme BOTELHO (chorégraphie), Sideway Rain, un spectacle de Alias, présenté au Festival TransAmérique les 24 et 25 mai 2012.
« Ce qui m'intéressait, c'était d'être aspiré comme je le suis par certains tableaux, comme ceux d'Edward Hopper : il peint des situations où on sent qu'il se passe quelque chose d'important, mais on ne sait pas quoi. Il y a ce type de théâtralité dans la pièce... C'est une autre forme de danse-théâtre, une autre manière de relier des gestes concrets et du mouvement abstrait. »Très belle pièce : pour une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir, et ai ressenti une belle émotion. J'ai donc été un bon spectateur...
vendredi 18 mai 2012
Focus - Disparition de Dominique Rolin - Newsletter du Magazine Littéraire
J'avais un peu suivi Diminique Rolin il y a une bonne vingtaine d'années. Vraiment un bon écrivain.
Focus - Disparition de Dominique Rolin - Newsletter du Magazine Littéraire
Focus - Disparition de Dominique Rolin - Newsletter du Magazine Littéraire
jeudi 17 mai 2012
D.B. comme M.D.
Éric Chevillard, dans Le Monde, a lu le nouveau roman, L'Anglais, de notre Grande Mademoiselle. On le plaint, mais le remercie de cette belle critique de la vacuité bombardière. À lire dans l'édition de ce vendredi. Dire que l'on a aimé serait peu, mais, comme on dit ici, on se gardera une "petite gêne".
Rédigé sur mon iPad.
« Peut-être est-il bon de s'infliger parfois la lecture d'un mauvais livre. Par pénitence, pour se punir, pour se mortifier. Méritons-nous vraiment de ne fréquenter que des chefs-d'oeuvre, comme si le meilleur nous était dû, comme si notre infaillible noblesse nous dispensait de composer jamais avec la médiocrité ? Et si cette macération expiatoire sent un peu trop le couvent, alors ne pourrait-on aventurer que la lecture de mauvais livres est encore une fine stratégie de la jouissance tendue vers son acmé : le terme de la souffrance ? Ainsi nous apprécions mieux le sol ferme sous nos pieds après la pénible traversée du marais. Et notre appréhension des chefs-d'oeuvre auxquels nous retournerons ensuite sera plus nette puisque nous aurons parcouru la distance qui les sépare du magma élémentaire des mots inorganisés. Pour ces raisons, il me paraît donc sain de conserver un peu de curiosité pour les mauvais livres. »
Rédigé sur mon iPad.
mardi 15 mai 2012
Thérèse Desquéroux
François MAURIAC, Thérèse Desqueyroux, in Œuvres romanesques et théâtrales complètes, tome II, Bibliothèque de la Pléiade - Gallimard, Paris, 1979 (1392 pages). Aussi disponible en format de poche et ePub.
 Était-ce en 1969, le cours de Français 101 consacré au roman ? J'ai retrouvé la couverture de l'édition de poche, d'une sorte de réalisme expressionniste dont, pour moi, celle du Bonjour Tristesse de Françoise Sagan demeure toujours en mémoire. Livre, celui-là, je l'ai prêté à un ami, il y a quelques temps déjà, qu'avait séduit un regain de ferveur de ma part provoqué par une série d'émissions radiophoniques, chez qui il semble installé à demeure, celui-ci ne l'ayant jamais terminé. Par quelle raison sentimentale suis-je attaché à cette vieille édition de poche au papier jauni et friable des années cinquante -- la prescription acquisitive court-elle toujours ? Mais foin de la digression. J'étais un adolescent sortant comme bien d'autres des Largarde et Michard du secondaire et ne m'adonnant guère au roman -- tous les Bob Morane et autres assimilés que dévoraient mes rares amis --, leur préférant les biographies et livres d'Histoire, notamment ceux de la collection La vie quotidienne au temps de ..., au grand déplaisir de certains de mes maîtres, lesquels eussent préféré me voir lire davantage de fiction, et pourtant, n'y a-t-il pas plus fertile pour l'imagination que ces vies illustres des temps anciens ? Rois et reines, papes et présidents, j'étais insatiable et intarissable.
Était-ce en 1969, le cours de Français 101 consacré au roman ? J'ai retrouvé la couverture de l'édition de poche, d'une sorte de réalisme expressionniste dont, pour moi, celle du Bonjour Tristesse de Françoise Sagan demeure toujours en mémoire. Livre, celui-là, je l'ai prêté à un ami, il y a quelques temps déjà, qu'avait séduit un regain de ferveur de ma part provoqué par une série d'émissions radiophoniques, chez qui il semble installé à demeure, celui-ci ne l'ayant jamais terminé. Par quelle raison sentimentale suis-je attaché à cette vieille édition de poche au papier jauni et friable des années cinquante -- la prescription acquisitive court-elle toujours ? Mais foin de la digression. J'étais un adolescent sortant comme bien d'autres des Largarde et Michard du secondaire et ne m'adonnant guère au roman -- tous les Bob Morane et autres assimilés que dévoraient mes rares amis --, leur préférant les biographies et livres d'Histoire, notamment ceux de la collection La vie quotidienne au temps de ..., au grand déplaisir de certains de mes maîtres, lesquels eussent préféré me voir lire davantage de fiction, et pourtant, n'y a-t-il pas plus fertile pour l'imagination que ces vies illustres des temps anciens ? Rois et reines, papes et présidents, j'étais insatiable et intarissable.
1969, et au programme Le père Goriot, Thérèse Desqueyroux et L'avalée des avalés. On n'accusera pas les bons pères de la Compagnie d'obscurantisme littéraire, ou bien était-ce le programme imposé par le ministère ? 1835, 1927 et 1966. Pour nous, la deuxième date était comparable à la première pour ce qui est de l'ancienneté, un livre ayant l'âge de nos parents n'était pas moins vieux -- périmé ? que le premier, témoin : on s'y déplaçait encore en calèche. Écoutait-on alors de la musique vielle de quarante ans ? Et pourtant, aujourd'hui, je ne gagerais pas que le benjamin de ces titres ait mieux vieilli que les ainés; ou bien est-ce une des conséquences de mon propre vieillissement ?
Thérèse Desqueyroux, donc. Et grâce à Marguerite D., car tels sont les mystères des correspondances littéraires. À peine quinze ans séparent ces deux romans, le premier sous la plume d'un quadragénaire déjà installé dans les lettres, le second, d'une inconnue qui se cherche encore une voix : l'un et l'autre bourgeois et ruraux.
Le hasard faisant bien les choses, j'apprends que l'adaptation cinématographique qu'en a faite le réalisateur français Claude Miller, récemment décédé, sera le film de clôture du Festival de Cannes. Dans le rôle titre, Audrey Tautou.
Nous y reviendrons.
1969, et au programme Le père Goriot, Thérèse Desqueyroux et L'avalée des avalés. On n'accusera pas les bons pères de la Compagnie d'obscurantisme littéraire, ou bien était-ce le programme imposé par le ministère ? 1835, 1927 et 1966. Pour nous, la deuxième date était comparable à la première pour ce qui est de l'ancienneté, un livre ayant l'âge de nos parents n'était pas moins vieux -- périmé ? que le premier, témoin : on s'y déplaçait encore en calèche. Écoutait-on alors de la musique vielle de quarante ans ? Et pourtant, aujourd'hui, je ne gagerais pas que le benjamin de ces titres ait mieux vieilli que les ainés; ou bien est-ce une des conséquences de mon propre vieillissement ?
Thérèse Desqueyroux, donc. Et grâce à Marguerite D., car tels sont les mystères des correspondances littéraires. À peine quinze ans séparent ces deux romans, le premier sous la plume d'un quadragénaire déjà installé dans les lettres, le second, d'une inconnue qui se cherche encore une voix : l'un et l'autre bourgeois et ruraux.
Le hasard faisant bien les choses, j'apprends que l'adaptation cinématographique qu'en a faite le réalisateur français Claude Miller, récemment décédé, sera le film de clôture du Festival de Cannes. Dans le rôle titre, Audrey Tautou.
Nous y reviendrons.
lundi 14 mai 2012
Pastiche
Marguerite DURAILLE, Mururoa mon amour (présenté par Patrick RAMBAUD), JC Lattès, Paris, janvier 1996 (141 pages).
Dans la foulée du premier Duras, Les Impudents, j'ai relu, il ne faut guère plus d'une heure, et avec autant de plaisir qu'à l'époque, le pastiche fait par Patrick Rambaud, dont on se souviendra des Chroniques du règne de Nicolas Ier.
« Après avoir fait le vide autour du texte, Madame Duraille installe ce vide à l'intérieur même du texte, à notre plus grande joie.
Ce livre, il manquait.
C'est ce que j'ai fait de plus important. On pourrait le lire sans rien, sans les mots. Sans le lecteur aussi. C'était la seule chose à faire. C'est extrêmement calé. Culotté presque, en un sens. Ou bien le contraire, parce que les mots, ici, on dirait qu'ils posent culotte. La voix qui parle n'est pas celle de Marguerite D. C'est la voix des lettres sur le papier, là ou ça s'écrit. Le sens, il se dispose tout seul sans qu'on le cherche. Ça n'a jamais été fait comme ça. Il y a du scandale, dans cette façon de dire avec les mots. Il y a aussi du génie là-dedans. Tout le monde le sait. Ça doit décourager de faire d'autre livres après moi. »
Libellés :
Marguerite Duraille,
Marguerite Duras,
pastiche,
Patrick Rambaud
dimanche 13 mai 2012
Durassique Parc
Marguerite DURAS, Les Impudents, in Œuvres complètes,
vol. 1, Bibliothèque de la Pléiade - Gallimard, Paris, 2011. Première
édition chez Plon en 1943, édition en poche chez Folio - Gallimard.
L'on me pardonnera la facilité de ce calembour -- « fiente de l'esprit qui vole », il est encore tôt pour le mien, d'esprit, encore pris dans des brumes matutinales et dominicales. C'est qu'il y a comme de l'archéologie dans ce tout premier roman de M. D., mais, à dire le vrai, pas à mon avis grand intérêt.
On le sait, la Pléiade constitue un monument pour tout auteur qui y figure; et si pour le lecteur, la visite doit bien commencer quelque part, ce ne sera pas, avec ce livre, dans les grands salons donnant sur le parc, mais dans les fondations. Il y découvrira les pierres qui constitueront le socle de l'œuvre à venir : une mère injuste, un frère ainé veule et incapable, une jeune femme qui veut échapper à sa famille recomposée, un amant, une propriété à sauver -- comme dans Un barrage contre le Pacifique et L'amant notamment. Pas d'amour. Comme il s'agit d'un roman bourgeois : de l'argent, l'obsession de l'argent, lequel n'est pas que le nerf de la guerre, mais aussi de la famille. Chose étrange d'ailleurs que cette famille reconstituée : la mère Marie, veuve Grand, devenue par son second mariage Taneran; les enfants des deux lits vivant ensemble; pas beaucoup de père, le premier mort, le second fantomatique. Certains commentateurs y ont vu un monde à la François Mauriac, celui de Thérèse Desquéroux, mais rural plus que provincial. Quoiqu'il en soit, le lecteur ne sera pas mécontent de sortir de la crypte...
Que nous en dit-elle, M. D. ?
L'on me pardonnera la facilité de ce calembour -- « fiente de l'esprit qui vole », il est encore tôt pour le mien, d'esprit, encore pris dans des brumes matutinales et dominicales. C'est qu'il y a comme de l'archéologie dans ce tout premier roman de M. D., mais, à dire le vrai, pas à mon avis grand intérêt.
On le sait, la Pléiade constitue un monument pour tout auteur qui y figure; et si pour le lecteur, la visite doit bien commencer quelque part, ce ne sera pas, avec ce livre, dans les grands salons donnant sur le parc, mais dans les fondations. Il y découvrira les pierres qui constitueront le socle de l'œuvre à venir : une mère injuste, un frère ainé veule et incapable, une jeune femme qui veut échapper à sa famille recomposée, un amant, une propriété à sauver -- comme dans Un barrage contre le Pacifique et L'amant notamment. Pas d'amour. Comme il s'agit d'un roman bourgeois : de l'argent, l'obsession de l'argent, lequel n'est pas que le nerf de la guerre, mais aussi de la famille. Chose étrange d'ailleurs que cette famille reconstituée : la mère Marie, veuve Grand, devenue par son second mariage Taneran; les enfants des deux lits vivant ensemble; pas beaucoup de père, le premier mort, le second fantomatique. Certains commentateurs y ont vu un monde à la François Mauriac, celui de Thérèse Desquéroux, mais rural plus que provincial. Quoiqu'il en soit, le lecteur ne sera pas mécontent de sortir de la crypte...
Que nous en dit-elle, M. D. ?
« En 1943, j'avais un roman de bout en bout, ça s'appelait Les Impudents. C'était très mauvais, mais, enfin, il était là ce roman. Je ne l'ai jamais relu. Ce qui est écrit est fait, je ne le relis jamais. Personne n'a voulu de ce roman. Chez Denoël on m'a dit : "Vous aurez beau faire, vous ne serez jamais un écrivain." Et puis Plon l'a pris... Comme tout le monde j'avais écrit ce roman pour me décharger d'une adolescence que l'on croit toujours singulière, chargée d'une signification unique -- ce qu'on peut être bête ! Lorsqu'on commence à écrire, il faudrait mettre son premier roman au tiroir. J'avais vingt-quatre ans et j'étais très niaise. [...] »Niaise, mais point sotte la dame.
Citation
Un Malraux pour ce dimanche matin :
« Le plus grand mystère n'est pas que nous soyons jetés au hasard sur la terre. C'est que dans cette prison, nous tirions de nous-mêmes des images assez puissantes pour nier notre néant. »
samedi 12 mai 2012
Parole de toutologue
Le journalisme dixit Soljenitsyne : « le deuxième plus vieux métier du monde ».
jeudi 10 mai 2012
Non, vous ne lirez pas Rinaldi !
Angelo RINALDI, Le roman sans peine : chroniques littéraires, Les empêcheurs de penser en rond/La Découverte, Paris, janvier 2012 (325 pages).
Un mot d'explication sur le titre. Vu la série d'admonestations, admonitions, exhortations, incitations, recommandations, pourquoi diantre, et frappé par quel révisionnisme, vous déconseillerais-je de lire l'auteur dont je n'ai cessé de vous parler ? En outre, aviez-vous pensé à la lecture de mon dernier billet, il en a fini avec Rinaldi. Détrompez-vous, je persiste (et généralement signe) avec ce recueil de chroniques littéraires parues entre 2003 et 2005 quand notre académicien était encore au Figaro (d'où il a été jeté, comme un vilain, la retraite atteinte). Mais vous ne le lirez pas, car le Sire Péladeau, dont l'une des convergentes échoppes se charge de la distribution dans nos contrées des éditions La Découverte, a décidé, en sa financière sagesse, que nous n'en étions pas dignes (alors qu'il avait distribué Dans un état critique) -- la prochaine fois que l'on croquera dans un financier, l'on s'autorisera, ce sire, à le maudire in petto. À défaut d'acquérir l'ouvrage à prix d'or auprès de quelque amazone virtuelle, vous devrez, comme je l'ai fait, vous rabattre sur la Bibliothèque nationale -- grâce soit rendue à cette généreuse institution --, laquelle m'a signifié son arrivée hier, arrivée qui m'a fait prestement porter mes pas vers celle-ci, puis, l'emprunt effectué, vers mon habituel salon de thé où, attablé avec un suave Anji Bai Cha, j'ai pu, dans l'atmosphère recueillie de l'établissement, le feuilleter en toute sérénité.Rinaldi critique : mon modèle, ai-je déjà avoué. Il ne s'en fait plus guère de ce genre, l'époque se contentant d'aimer ou de ne pas aimer, pourvu qu'il y ait une histoire, dans un bouillon promotionnel tiédasse. Tenez les incipit suivants, croyez-vous qu'ils surgiraient des clavier de nos folliculaires culturels ?
« Pour un écrivain, l'enfance c'est du passé qui a toujours de l'avenir. Au bout de la route, elle lui inspire souvent un chef-d’œuvre, outre l'occasion de constater qu'il ne fut, à aucun moment, un adulte, et que l'on sort trop tard des premières années. » (sur Notre après-guerre de Dominique Jamet).
« Quand on lui parlait de Hiroshima mon amour, Marguerite Yourcenar répondait : "Pourquoi pas Auschwitz, mon chou ?" Elle soulignait par là l'indécence qui consiste chez un homme de lettres à raccorder un livre à un désastre, aux fins de lui communiquer, par capillarité, un peu de la force dont il est, pour son compte, dépourvu. Du charnier considéré comme un autre Viagra en remède à l'impuissance créatrice. » (sur Windows on the World de Frédéric Beigbeder).
Présentation de l'éditeur :
« " Le Grand Mamamouchi et la dame de trèfle ", " Bécassine sur le divan ", " Des roses rouges pour Willi ", " L'enchantement au bord du lac " ou encore " La marquise sortit après le couvre - feu " On trouvera ici quantité d'histoires courtes, graves ou désopilantes, qu'on dirait être des contes - cruels, féeriques, licencieux ou à dormir debout -, en vérité tranches de vie. Issues des innombrables lectures d'Angelo Rinaldi - biographies, Mémoires, Journaux, correspondances, d'écrivains mais pas seulement, et bien sûr romans -, elles lui sont aussi inspirées par le souvenir de ses rencontres. Les plus divines, souvent, il les a faites à l'" Internationale des petites gens ", au coin de la rue ou au zinc d'en face. Ainsi avec ce ferrailleur manouche qui, rappelant que Django Reinhardt devait son toucher unique au handicap de ses deux doigts brûlés à la main gauche, lui inspire cette réflexion : " L'artiste est dans l'usage qu'il fait de sa blessure. " Le reste n'est que travail. Mais quel ! chez ces John McGahern, Flannery O'Connor, Jean Rhys, Roger Grenier, Dominique Fabre, dont la discrétion est à la mesure du talent, quand tant de faiseurs et faisans font les têtes de gondole.
» Entre mille choses, on apprendra que " le génie de Proust était d'essence comique " et que Milan Kundera ne se prend pas pour rien. Avec son humour et ses aperçus étonnants, qu'il loue ou qu'il fustige, lire Rinaldi est un bonheur, comme seul le style d'un romancier en dispense, la critique littéraire selon lui exigeant d'être à la fois juge et partie. »
mercredi 9 mai 2012
Pépère
Christophe SPIELBERGER, Pépère, Éditions L'une et l'autre, mai 2012, 144 pages.
Je viens d'apprendre la publication, en France, de Pépère, le nouveau roman de cet auteur que je fréquente, en lecture, depuis quelques années. J'espère que cet éditeur est distribué de ce côté-ci de l'Atlantique. Jetez un coup d’œil à son site, vous y verrez qu'il manie aussi fort bien l'appareil photo et le pinceau.
Je viens d'apprendre la publication, en France, de Pépère, le nouveau roman de cet auteur que je fréquente, en lecture, depuis quelques années. J'espère que cet éditeur est distribué de ce côté-ci de l'Atlantique. Jetez un coup d’œil à son site, vous y verrez qu'il manie aussi fort bien l'appareil photo et le pinceau.
 |
| Chemin de vert, C. Spielberger |
mardi 8 mai 2012
Les souvenirs sont au comptoir
Angelo RINALDI, Les souvenirs sont au comptoir, Fayard, Paris, février 2012 (376 pages); support papier et epub sous DRM.

Me voici, enfin, parvenu, si j'ose dire, au bout du comptoir, dont j'aurai fait, deux fois plutôt qu'une, le tour, l'ayant rapidement relu le weekend dernier, le tout sur liseuse (et, à l'occasion, sur la tablette). Il en a déjà, sur ces pages, amplement été question, mais, las! je crains de ne pas avoir persuadé au moindre d'entre vous qu'il fallait le lire. Aurais-je dû, mortel, glisser et non point appuyer ? Quoiqu'il en soit, en un ultime rappel, le rideau tombé, ayant déjà traité du style, je me contenterai de vous en esquisser l'intrigue.
En quelques mots : Conti se remémore un dîner donné par Delozier, un confrère, il y a un quart de siècle pour souligner son quarantième anniversaire de naissance où sont conviés une quarantaine de personnalités. Conti ? Est-ce une référence au quai du même nom où se trouve l'Institut de France, sous la coupole duquel siège l'Académie française, cénacle où un certain Rinaldi est, en 2001, entré dans l'immortalité ? De plus, ce Conti, agent de finance dans une grande banque est, comme l'auteur, originaire de Corse, qui, si j'ose la comparaison, est, s'agissant de ses mœurs, à la France ce que la Sicile est à l'Italie. Je me risque à affirmer que les véritables protagonistes du roman sont les souvenirs d'une vie remontant à la surface de la mémoire comme autant de bulles d'air à celle d'un plan d'eau et qui se fondent les uns dans les autres appelant et rappelant personnages et situations depuis une enfance insulaire jusqu'à une vie dans le monde de Paris -- de la banque, de la presse. S'il arrive qu'un nom prend du temps à se fixer sur un visage de naguère ou d'autrefois, il finira toujours par apparaître, fût-ce grâce à des souvenirs parallèles, et le récit de rejaillir vers de nouvelles évocations, le présent ne servant que d'appui à un mouvement perpétuel d'innombrables « hier encore... ».
Au bout du compte, les souvenirs ne sont-ils pas les plus beaux, et durables, monuments funéraires ?
(version remaniée 2012.05.09/20:22)

Me voici, enfin, parvenu, si j'ose dire, au bout du comptoir, dont j'aurai fait, deux fois plutôt qu'une, le tour, l'ayant rapidement relu le weekend dernier, le tout sur liseuse (et, à l'occasion, sur la tablette). Il en a déjà, sur ces pages, amplement été question, mais, las! je crains de ne pas avoir persuadé au moindre d'entre vous qu'il fallait le lire. Aurais-je dû, mortel, glisser et non point appuyer ? Quoiqu'il en soit, en un ultime rappel, le rideau tombé, ayant déjà traité du style, je me contenterai de vous en esquisser l'intrigue.
En quelques mots : Conti se remémore un dîner donné par Delozier, un confrère, il y a un quart de siècle pour souligner son quarantième anniversaire de naissance où sont conviés une quarantaine de personnalités. Conti ? Est-ce une référence au quai du même nom où se trouve l'Institut de France, sous la coupole duquel siège l'Académie française, cénacle où un certain Rinaldi est, en 2001, entré dans l'immortalité ? De plus, ce Conti, agent de finance dans une grande banque est, comme l'auteur, originaire de Corse, qui, si j'ose la comparaison, est, s'agissant de ses mœurs, à la France ce que la Sicile est à l'Italie. Je me risque à affirmer que les véritables protagonistes du roman sont les souvenirs d'une vie remontant à la surface de la mémoire comme autant de bulles d'air à celle d'un plan d'eau et qui se fondent les uns dans les autres appelant et rappelant personnages et situations depuis une enfance insulaire jusqu'à une vie dans le monde de Paris -- de la banque, de la presse. S'il arrive qu'un nom prend du temps à se fixer sur un visage de naguère ou d'autrefois, il finira toujours par apparaître, fût-ce grâce à des souvenirs parallèles, et le récit de rejaillir vers de nouvelles évocations, le présent ne servant que d'appui à un mouvement perpétuel d'innombrables « hier encore... ».
Au bout du compte, les souvenirs ne sont-ils pas les plus beaux, et durables, monuments funéraires ?
(version remaniée 2012.05.09/20:22)
mercredi 2 mai 2012
Le Premier Homme
Albert CAMUS, Le premier Homme, in Œuvres complètes IV, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1994/2008 (250 pages). Aussi en Folio.
Comme on retrouve sur le site consacré à Albert Camus un très bon exposé (Notes de lecture) des principaux thèmes du roman, je me contenterai -- à quoi bon gloser ? de vous y référer, de même qu'au très intéressant commentaire, Le mythe d'Adam, qu'en fait Joseph Jurt.
Le premier homme est bien, en dépit de son caractère autobiographique, une œuvre de fiction -- je rappelle qu'on en a trouvé le manuscrit dans la voiture où, en janvier 1960, Camus a trouvé la mort. Roman inachevé dont la famille n'a autorisé la publication qu'en 1994. Je ne m'explique pas pourquoi je ne l'ai pas lu à cette époque, je me souviens de la très large couverture médiatique, mais déjà, et cela n'a pas changé, et telle est vraisemblablement la cause de mon abstention, je ressentais la plus grande méfiance envers tous les « roman incontournable », « Le Camus à lire » et autres « chef d’œuvre ». Et puis le temps passe... Méfiance qui me place en porte-à-faux, l'objet de mes carnets de lecture n'étant-il pas, témoin mon récent enthousiasme pour Les souvenirs sont au comptoir d'Angelo Rinaldi, de piquer votre intérêt pour tel ou tel livre, ou de vous en dissuader la lecture ? On se veut cicerone littéraire, mais peut-on l'avouer ? Un brin de mauvaise foi, mais comment y échapper ?
Revenons au texte :
J'ai ressenti une très forte impression de luminosité au récit par le narrateur, Jacques Cormery, maintenant au début de la quarantaine, de son retour en Algérie : le soleil de l'Algérie ? Lumineuse également la prose, en dépit de l'inachèvement de l’œuvre. Roman identitaire dirait-on de nos jour -- où il n'y a plus guère que des individus incertains -- que ce texte d'une recherche du père mort alors que le narrateur n'avait que quelques mois et qu'il n'a donc pas connu, élevé dans un monde de femmes : sa mère et sa grand-mère; ainsi, l'homme qui n'a pas connu son père sera-t-il toujours un premier homme (peut-être comme on parle d'un nombre premier ?)
Autre thème : la pauvreté. Celle de la vie quotidienne, certes; mais surtout celle qui est éprouvée sous le regard de l'autre et qui fait naître la honte. Pauvreté dans une société qui ne connaît aucune forme d'aide autre que celle du cadre familial; pauvreté de classe, cela va de soi, et pourtant bien différente pour les colons, Français installés en Algérie, et pour les Algériens « de souche » -- si j'osais un parallèle avec la société québécoise de l'entre-deux guerres, j'opposerais la différence de perception de la pauvreté pour les Anglais et les Canadiens, les premiers étant globalement perçus par les seconds comme dominants, alors que, au sein de chaque groupe, il y avait des classes laborieuses ou misérables : la pauvreté de Griffin Town n'étant pas, en réalité, très différente de celle du Faubourg à la m'lasse. Mais s'il y a la honte, il y a aussi une sorte dignité de la pauvreté, qu'il m'est difficile de définir, mais que Camus peint très bien : celle de travailler dur, très dur, pour échapper à la misère, celle de la solidarité à l'intérieur de la famille.
C'est d'ailleurs le même thème de la pauvreté, puisque l'on donne dans le parallèle, qui forme la « basse continue » du roman Les souvenirs sont au comptoir, bien que le traitement en soit différent, plus intériorisé chez Rinaldi, plus existentiel ou social chez Camus. Une constante : la honte de la honte; chez l'un et l'autre des narrateurs, ce sentiment à deux coups, la honte éprouvée face au regard jeté sur sa propre pauvreté -- comme une nudité obscène --, puis celle, plus douloureuse encore, empreinte de culpabilité, d'avoir honte d'un des siens, en l'instance leur mère : sentiment qui, bien plus que l'âge, les fait entrer dans la condition humaine.
Quatrième de couverture de la première édition :
Quelques extraits :
Comme on retrouve sur le site consacré à Albert Camus un très bon exposé (Notes de lecture) des principaux thèmes du roman, je me contenterai -- à quoi bon gloser ? de vous y référer, de même qu'au très intéressant commentaire, Le mythe d'Adam, qu'en fait Joseph Jurt.
Le premier homme est bien, en dépit de son caractère autobiographique, une œuvre de fiction -- je rappelle qu'on en a trouvé le manuscrit dans la voiture où, en janvier 1960, Camus a trouvé la mort. Roman inachevé dont la famille n'a autorisé la publication qu'en 1994. Je ne m'explique pas pourquoi je ne l'ai pas lu à cette époque, je me souviens de la très large couverture médiatique, mais déjà, et cela n'a pas changé, et telle est vraisemblablement la cause de mon abstention, je ressentais la plus grande méfiance envers tous les « roman incontournable », « Le Camus à lire » et autres « chef d’œuvre ». Et puis le temps passe... Méfiance qui me place en porte-à-faux, l'objet de mes carnets de lecture n'étant-il pas, témoin mon récent enthousiasme pour Les souvenirs sont au comptoir d'Angelo Rinaldi, de piquer votre intérêt pour tel ou tel livre, ou de vous en dissuader la lecture ? On se veut cicerone littéraire, mais peut-on l'avouer ? Un brin de mauvaise foi, mais comment y échapper ?
Revenons au texte :
J'ai ressenti une très forte impression de luminosité au récit par le narrateur, Jacques Cormery, maintenant au début de la quarantaine, de son retour en Algérie : le soleil de l'Algérie ? Lumineuse également la prose, en dépit de l'inachèvement de l’œuvre. Roman identitaire dirait-on de nos jour -- où il n'y a plus guère que des individus incertains -- que ce texte d'une recherche du père mort alors que le narrateur n'avait que quelques mois et qu'il n'a donc pas connu, élevé dans un monde de femmes : sa mère et sa grand-mère; ainsi, l'homme qui n'a pas connu son père sera-t-il toujours un premier homme (peut-être comme on parle d'un nombre premier ?)
Autre thème : la pauvreté. Celle de la vie quotidienne, certes; mais surtout celle qui est éprouvée sous le regard de l'autre et qui fait naître la honte. Pauvreté dans une société qui ne connaît aucune forme d'aide autre que celle du cadre familial; pauvreté de classe, cela va de soi, et pourtant bien différente pour les colons, Français installés en Algérie, et pour les Algériens « de souche » -- si j'osais un parallèle avec la société québécoise de l'entre-deux guerres, j'opposerais la différence de perception de la pauvreté pour les Anglais et les Canadiens, les premiers étant globalement perçus par les seconds comme dominants, alors que, au sein de chaque groupe, il y avait des classes laborieuses ou misérables : la pauvreté de Griffin Town n'étant pas, en réalité, très différente de celle du Faubourg à la m'lasse. Mais s'il y a la honte, il y a aussi une sorte dignité de la pauvreté, qu'il m'est difficile de définir, mais que Camus peint très bien : celle de travailler dur, très dur, pour échapper à la misère, celle de la solidarité à l'intérieur de la famille.
C'est d'ailleurs le même thème de la pauvreté, puisque l'on donne dans le parallèle, qui forme la « basse continue » du roman Les souvenirs sont au comptoir, bien que le traitement en soit différent, plus intériorisé chez Rinaldi, plus existentiel ou social chez Camus. Une constante : la honte de la honte; chez l'un et l'autre des narrateurs, ce sentiment à deux coups, la honte éprouvée face au regard jeté sur sa propre pauvreté -- comme une nudité obscène --, puis celle, plus douloureuse encore, empreinte de culpabilité, d'avoir honte d'un des siens, en l'instance leur mère : sentiment qui, bien plus que l'âge, les fait entrer dans la condition humaine.
Quatrième de couverture de la première édition :
« En somme, je vais parler de ceux que j’aimais », écrit Albert Camus dans une note pour LE PREMIER HOMME. Le projet de ce roman auquel il travaillait au moment de sa mort était ambitieux. Il avait dit un jour que les écrivains « gardent l’espoir de retrouver les secrets d’un art universel qui, à force d’humilité et de maîtrise, ressusciterait enfin les personnages dans leur chair et dans leur durée ».
Pour commencer, il avait jeté les bases de ce qui serait le récit de l’enfance de son « premier homme ». Cette rédaction initiale a un caractère autobiographique qui aurait sûrement disparu dans la version définitive du roman. Mais c’est justement ce côté autobiographique qui est précieux aujourd’hui. Camus y rapporte, avec mille détails inconnus, la naissance dans l’Est sauvage de l’Algérie. L’absence du père, tué dès le début de la Première Guerre, de sorte que le fils sera « le premier homme ». Les jours de l’enfance à Belcourt, le « quartier pauvre » d’Alger, dans un milieu démuni, illettré. Les joies des humbles. L’école, l’intervention miraculeuse de l’instituteur pour que l’enfant poursuive ses études, tout un petit monde, tantôt drôle et chaleureux, tantôt cruel, et des personnages faits d’amour, comme sa mère, toujours silencieuse. Ces tableaux ne forment pas seulement une histoire colorée, mais aussi une confession qui bouleverse.
Après avoir lu ces pages, on voit apparaître les racines de ce qui fera la personnalité de Camus, sa sensibilité, la genèse de sa pensée, les raisons de son engagement. Pourquoi, toute sa vie, il aura voulu parler au nom de ceux à qui la pensée est refusée.
« La mémoire des pauvres déjà est moins nourrie que celle des riches, elle a moins de repères dans l'espace puisqu'ils quittent rarement le lieu où ils vivent, moins de repères aussi dans le temps d'une vie uniforme et grise. Bien sûr, il y a la mémoire du cœur dont on dit qu'elle est la plus sûre, mais le cœur s'use à la peine et au travail, il oublie plus vite sous le poids des fatigues. »
« Le temps perdu ne se retrouve que chez les riches. Pour les pauvres il marque seulement les traces vagues du chemin de la mort. Et puis pour bien supporter il ne faut pas trop se souvenir... »
« Car lui-même croyait vivre, il s'était édifié seul, il connaissait sa force, son énergie, il faisait face et se tenait en mains. Mais dans le vertige étrange où il était en ce moment, cette statue que tout homme finit par ériger et durcir au feu des années pour s'y couler et y attendre l'effritement dernier se fendillait rapidement, s'écroulait déjà. »
« Et sans doute ce qu'ils aimaient si passionnément en [l'école] , c'est ce qu'ils ne trouvaient pas chez eux, ou la pauvreté et l'ignorance rendaient la vie plus dure, plus morne, comme refermée sur elle-même; la misère est une forteresse sans pont-levis. »
S'abonner à :
Messages (Atom)