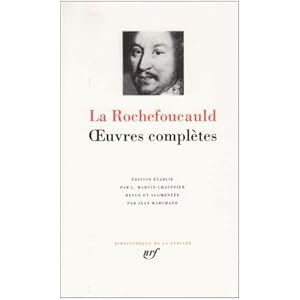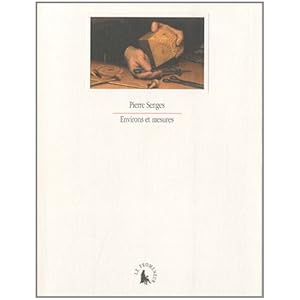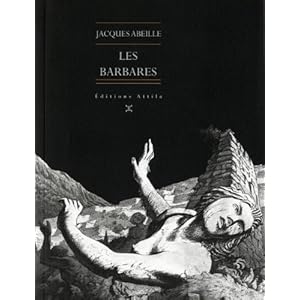Qui n'a pas, une fois, visité le site d'une ancienne habitation humaine, village, ville, château -- je songe à Carthage, à Pompéi, à Montségur ? Et aura imaginé la vie quotidienne en ces temps-là. Ou ces villes devenues fantômes, villes champignon qui surgirent pendant la ruée vers l'or au XIXe siècle, ou autour d'une exploitation minière ou industrielle dont elles étaient tributaires et disparurent à la fermeture de celle-ci.
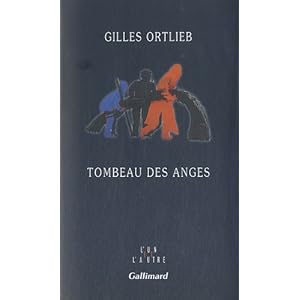 « Que reste-t-il lorsqu'il ne reste plus rien, lorsque tout ou presque a disparu ? » se demande l'auteur de Le tombeau des anges, très belle évocation du temps qui passe et du présent qui se survit en Lorraine, ancien foyer sidérurgique de la France dont le déclin s'est étendu sur un bon quart de siècle. On parcourt avec lui ces villes en « ange » qui portent encore les traces, comme autant de cicatrices, de ces établissements grandioses et gigantesques, maintenant détruits ou réhabilités, qui en étaient le cœur au temps du grand capitalisme industriel des XIXe et XXe siècles. Par parenthèses, on aurait aimé une explication sur l'étymologie de la terminaison « ange » mais sachons que, en allemand -- cette province, duché jusqu'en 1766, ayant été, au fil des siècles tantôt française, tantôt allemande -- elle était en « ingen ».
« Que reste-t-il lorsqu'il ne reste plus rien, lorsque tout ou presque a disparu ? » se demande l'auteur de Le tombeau des anges, très belle évocation du temps qui passe et du présent qui se survit en Lorraine, ancien foyer sidérurgique de la France dont le déclin s'est étendu sur un bon quart de siècle. On parcourt avec lui ces villes en « ange » qui portent encore les traces, comme autant de cicatrices, de ces établissements grandioses et gigantesques, maintenant détruits ou réhabilités, qui en étaient le cœur au temps du grand capitalisme industriel des XIXe et XXe siècles. Par parenthèses, on aurait aimé une explication sur l'étymologie de la terminaison « ange » mais sachons que, en allemand -- cette province, duché jusqu'en 1766, ayant été, au fil des siècles tantôt française, tantôt allemande -- elle était en « ingen ».« Terre-pleins et herbes folles ont beau, depuis, proposer leur propre définition du vide, ils parviennent rarement à faire oublier que le vide, dans ces cons qui auront un temps hébergé la plus forte concentration d'usines au monde, c'est d'abord et surtout de l'autrefois plein. »Le charme de ce Tombeau ne tient pas du tout d'une déploration nostalgique sur un âge d'or révolu; conforme à l'acception -- plus rare -- du terme, il émane d'une « composition poétique ... écrite à la mémoire d'un grand artiste » (Trésor de la Langue française), où le grand artiste serait la population victime de la désindustrialisation qui a détruit « ces villes de peu [...], ces agglomérations le plus souvent ingrates pour l’œil, et qu'on ne peut traverser sans se demander à la dérobée si et comment il serait possible d'y vivre -- sans rien ignorer naturellement, par avance, de la réponse. »
Certes on y voit, comme à Gandrange (devenue page 56 Grandrange), l'ensemble industriel « affalé de l'autre côté de la rivière, sous l'apparence d'un rhinocéros grisâtre, couleur de boue séchée et pas moins préhistorique d'allure, à la double corne en forme de tuyères fumantes » qu'est l'usine, mais on rencontre aussi ceux qui sont resté, vieux pour la plupart, qui vous parlent du temps d'avant, du temps où il y avait de l'emploi, là, au creux de la mine, et qui passent le temps qui leur reste dans l'un des quelques cafés qui n'a pas encore fermé. Je songe en particulier au très beau chapitre Le nom de Langres articulé au futur antérieur :
« Un samedi matin de juin, à deux pas de la rue Constance-Chlore qui donne sur le chemin de ronde, et pendant que les cloches de la cathédrale Saint-Mammès s'obstinaient à faire sonner, sur deux notes, ce qui aurait pu ressembler à un va-et-vient insistant entre passé, présent, passé, présent, passé, des sexagénaires en chemisette de toile et sandales ou espadrilles auront, sans hâte, remonté la rue Diderot qui est un peu la colonne vertébrale de ce poisson plat et haut perché, non ébarbé de ses remparts, que forme la ville de Langres. Un panier à la main, ... ils auront salué d'un signe de tête... »On ne pourra pas, par ailleurs, ne pas être touché par la série de lettres achetées « au prétexte des timbres » adressées à Mme Gisèle Crespin ou à l'un des siens entre le 20 août 1947 et le 21 octobre 1970.
Et dans trois ou quatre siècles, un passant sur la route des « anges » se demandera comment, autrefois, on a vécu ici, laissant libre cours à son imagination. Le beau livre de Gilles ORTLIEB nous donne accès à un temps désormais perdu et nous place dès maintenant, et avec un réel plaisir littéraire, dans cette situation de futur antérieur.
Présentation de l'éditeur :
« Ces « anges »-là n'ont rien de célestes, puisqu'il s'agit ici des terminaisons des noms de villes de cette région de Lorraine autour de Thionville, Florange, Hayange, Gandrange, Uckange, Hagondange et tant d'autres. Des localités de cette « vallée des anges » que l'on appelait aussi, il n'y pas si longtemps, la « vallée du fer ». De cette épopée sidérurgique, mines et aciéries étroitement imbriquées sur quelques centaines de kilomètres carrés, rien ou presque ne subsiste aujourd'hui : usines dépecées, cités ouvrières vidées, commerces en perdition. De ce constat d'un monde révolu, Gille Ortlieb tire un propos tout à la fois nostalgique et plein d'humour, à l'exemple de ces sinistres banlieues industrielles moribondes aux magasins minables, mais dont les rues portent des noms si bucoliques. Si les derniers vestiges s'effacent à coups de bulldozer, si les acteurs de cette épopée industrielle disparaissent les uns après les autres, Gilles Ortlieb n'idéalise pas pour autant le passé, dont la rudesse, la violence, parfois, ressurgit au fil des documents, par exemple ces motifs de licenciements, cités in extenso, témoins éloquents d'un temps où l'usine nourrissait l'homme, mais broyait l'individu.
Vous voudrez sans doute écouter l'auteur parler de son livre : France Culture : Du jour au lendemain, Gilles Ortlieb