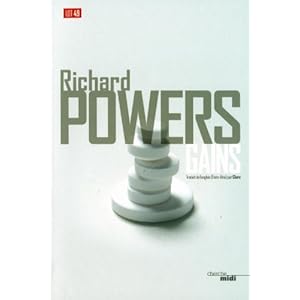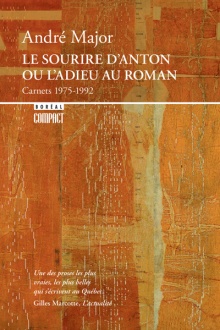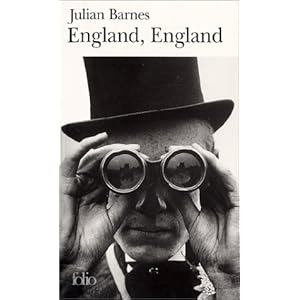Anton TCHÉKHOV, La Dame au petit chien, in Oeuvres III, La Pléiade, Gallimard, Paris, 1971 (1033 pages).
Anton TCHÉKHOV, La Dame au petit chien, in Oeuvres III, La Pléiade, Gallimard, Paris, 1971 (1033 pages).
Je mène désormais en parallèle avec trois auteurs un dialogue en lecture que rien ne semble épuiser, et auquel vous pouvez participer si vous avec la patience de me lire. À la base de ce triangle littéraire, les carnets aigres-doux d'André Major et le récit Regardez la neige tombe -- comme elle tombe, délicate, en cet après midi de fin décembre, pendant que je rédige ces lignes -- fort justement sous-titré Impressions de Tchékhov, qui vaut bien toutes les biographies du monde; au sommet, les récits -- comme les appelle le recueil de la Pléiade, mais que beaucoup qualifient de nouvelles -- de ce dernier, dont celui-ci, qui date de 1899.La neige tombe, et je m'identifie, avec je ne sais quelle mélancolie, aux pensées de Gourov, la personnage principal du récit :
« Des activités vaines et des conversations oiseuses toujours sur les mêmes sujets absorbent la meilleure partie de votre temps, le meilleur de vos forces, et, au bout du compte, il ne vous reste qu'une vie étriquée, aux ailes rognées, une vie de pacotille, et aucun moyen de s'en échapper, de fuir, c'est comme si l'on était enfermé à l'asile ou dans un pénitencier. »
« ... il arrive aussi [...] qu'une réflexion vous frappe avec la force et la vélocité d'une évidence, que vous faites vôtre aussitôt, un peu déçu tout de même de ne pas en être l'auteur. »Chez Grenier :
« Maintenant j'ai l'impression que j'ai appris à lire dans son œuvre et qu'à travers l'individu nommé Tchékhov qui vécut si loin d'ici, il y a un siècle, je reconnais et j'aime tout ce que l'on peut savoir d'un homme, les qualités et aussi les défauts. »
Au vrai, moins de la mélancolie qu'une certaine forme de lucidité, version moderne du gnôti séauton des Grecs, lequel n'est pas le « connais-toi toi-même » qu'en ont fait les Chrétiens, mais bien un « connais tes limites, connais ta condition ». Pourtant cette lucidité nous permettra-t-elle jamais de savoir qui nous sommes vraiment ? Si les autres ne la trouveront jamais, n'y a-t-il pas chez nous quelque aveuglement à prétendre connaître notre identité ?
Encore Gourov :
« Les femmes l'avaient toujours pris pour autre chose que ce qu'il était, ce n'était pas lui qu'elles aimaient en lui, mais un être né de leur imagination, qu'elles avaient avidement cherché à travers leur vie; puis, quand elles s'apercevaient de leur erreur, elles continuaient à l'aimer. Et pas une seule d'entre elle n'avait été heureuse avec lui. Le temps passait, amenant d'autres rencontres, d'autres liaisons, d'autres ruptures, mais jamais il n'avait aimé; c'était tout ce que l'on voulait mais pas de l'amour. »
Et l'on songe tout de suite à Swann et à Odette...
Pour moi, je connais bien des mariages qui n'auraient pas dû se faire ! Toujours la neige qui tombe, et Dietrich chante Want to buy some illusions...