André MAJOR, Le sourire d'Anton ou l'adieu au roman - Carnets 1975-1992, Boréal Compact, Montréal, réédition 2012 (187 pages).
Il y a exactement vingt ans aujourd'hui, André Major lisait Le neveu de Wittgenstein de Thomas Bernhard « aussi stimulant que Maîtres anciens, sans en avoir la richesse psychologique et la densité d'écriture » -- on pourra trouver plus léger pour les Fêtes. En parallèle avec l'auteur autrichien, contempteur de son pays, il réfléchit sur la manie bien québécoise de glorifier les « géants sortis de notre terroir, vedettes du sport, de la télé et des affaires dont les faits et gestes, à force d'occuper tant de place, finissent par nous tenir lieu de culture nationale. » Aujourd'hui, c'est en sa -- très bonne -- compagnie que je m'apprête à refermer une autre année de lecture, et de billets, ces carnets me poussant à m'interroger sur ma propre pratique du carnet qu'est, sur Internet, le blog : lecture et écriture comme élément d'une vie.J'aurai l'occasion de revenir sur ce recueil de carnets, et aussi sur Prendre le large, le plus récent de la série. Pour l'heure, il me suffira de dire combien je me sens proche de l'auteur, tant par ses goûts littéraires, son élitisme, son dégoût du monde et de son angoisse face à l'écriture, laquelle l'aura finalement poussé à renoncer au roman. Et de citer de larges extraits d'une lettre parue le 12 décembre 1992 dans Le Devoir sur la publication d'un dictionnaire Robert québécois, et qui lui a valu la vindicte des officiels de la culture. Vingt ans, et un vain référendum plus tard, qu'y a-t-il de changé ?
On voudra bien, pour ne pas désespérer le Plateau, écouter le Vigneault de Quand nous partirons pour la Louisiane, ou le Mommy de Pauline Julien.« L'acte culturel les plus révolutionnaire, dans le Québec actuel, c'est d'oser parler et écrire dans un français correct, exempt de toute concession au nationalisme culturel et à la mode vernaculaire qui tendent à vous faire croire qu'existe une langue québécoise. Si tel était le cas, nous cesserions d'être des francophones pour devenir des québécophones, espèce apparentée aux Louisianais d'origine acadienne. Une langue ne se réduit pas à un lexique, même s'il était la géniale invention d'un peuple tout aussi génial; c'est un ensemble de règles, une grammaire et une syntaxe. Quand les mots perdent leur sens, quand le délire populaire tient lieu de raisonnement intellectuel, il n'est pas superflu de rappeler certaines évidences, quitte à passer pour ce que M. Rey appelle un puriste exalté. On voit bien que ce monsieur n'habite pas ici, qu'il n'entend pas jour après jour et qu'il ne lit pas, tous les matins, la langue qui se parle et s'écrit ici. J'ose à peine imaginer la réaction des Français si leur Robert se trouvait du jour au lendemain truffé de termes argotiques, car c'est bien d'un argo qu'on entend justifier l'existence en intégrant à ce dictionnaire un lexique composé du meilleur et du pire, de tournures archaïques ou populaires mais aussi de fautes assez grossières, de termes branchés et surtout d'anglicismes dont nous n'arrivons plus à purger notre langue tant nous cultivons avec délectation nos propres déficiences.
Ce dictionnaire paraît à un moment où les médias utilisent une langue de plus en plus désarticulée grammaticalement, de plus en plus approximative sur le plan lexical, à un moment où certains artistes -- par souci d'authenticité, c'est à dire par démagogie pure -- participent allègrement à une véritable entreprise de régression langagière. [...] c'est du québécois que nous aurons un jour l'honneur douteux d'être traduits pour être compris dans la francophonie si nous continuons à creuser le fossé qui nous en sépare, comme une certaine élite souhaite. Aussi bien adopter tout de suite le parler twit, nouvelle appellation du joual des années 1960, et consacrer une fois pour toutes notre rupture avec notre langue d'origine puisqu'être francophones nous contraint à un dépassement qui nous semble au-dessus de nos faibles forces, à un apprentissage épuisant, toutes choses que notre médiocrité bonhomme ne supporte plus, il faut croire.
L'indigénisme de certains linguistes n'arrange rien, car, comme le disait l'un deux, nous utilisons un excellent français québécois, tout comme nous produisons le meilleur théâtre québécois au monde, selon Jean-Claude Germain. (Un peu comme le Canada selon Jean Chrétien serait le plus meilleur pays du monde au monde... -- se non è vero, è ben trovato ! nda) Il faut comprendre par là un français amélioré, tel que nous le proposait il n'y a pas si longtemps Léandre Bergeron, et qui nous autorise à partir une entreprise, comme si on pouvait partir quoi que ce soit, ou à supporter Centraide, comme s'il n'était pas suffisant de supporter la misère qu'elle nous invite à soulager. Autre exemple récent, que je prends dans Le Devoir : en manchette on nous apprend que Bourassa prétend avoir choisi « la moins pire des solutions » -- heureusement qu'il n'a pas choisi la plus pire. Pour ne pas perdre l'usage de notre langue -- si c'est toujours le français, bien entendu --, nous devons nous payer, à défaut d’œuvres littéraires, Le Monde ou Le Nouvel Observateur, n'importe quel journal où la maîtrise de la langue demeure un prérequis (si on me permet ce québécisme inventé par nos experts en pédagogie) (Cet appauvrissement linguistique a depuis également frappé ces journaux, las ! nda).
Au-delà de la langue, ou plutôt à travers elle,c'est une crise profonde qui se trouve ainsi dévoilée : celle d'un peuple victime d'une sorte d'anémie culturelle et qui, faute d'affirmer autrement sa différence, se replie sur une langue infantilisée. « Dis-le dans tes mots, moman va comprendre », tel devrait être le slogan publicitaire du Robert québécois qui n'est rien de plus que le vadémécum de notre rapetissement culturel.
[...]
Dans la maternelle québécoise, nous parlerons bébé, nous penserons quétaine et nous vieillirons en nous souvenant de cette époque où nous rêvions d'une improbable maturité collective. En attendant, nous ne manquons pas de comiques généreusement subventionnés pour nous faire mourir de rire. »
En conclusion, je me souviens d'avoir lu, à cette époque, dans Le Devoir, la fine fleur de notre intelligentsia journalistique les titres suivants : Au Québec, le saumon remonte la pente et Les Russes posent la première pierre de la station spatiale. On a la métaphore qu'on peut, et de rire de tel coach de hockey champion hors catégorie en la matière.
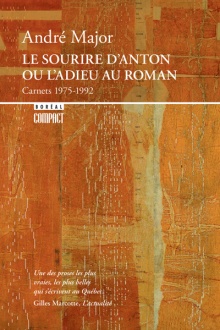
Aucun commentaire:
Publier un commentaire