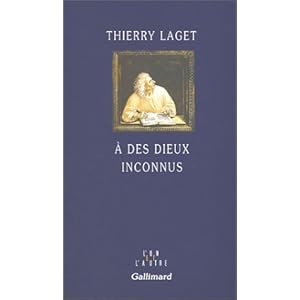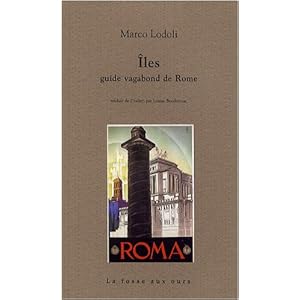Santiago H. Amigorena, La Première Défaite
P.O.L. Paris, août 2012, 632 pages; aussi disponible sous format ePub.
L'avantage de lire -- sans le cordon de la bourse délier -- un extrait de livre, est qu'on est vite fixé. Si, quelques pages lues, l'on accorde à l'auteur les quarante-cinq de l'extrait, c'est avec le soulagement de n'avoir pas à aller au delà. Mieux vaut se vouer à la recherche du temps perdu que de vaquer à perdre le sien. On ne délaissera donc pas Stendhal pour si peu.On apprendra, par ailleurs, dans la présentation faite sur tel site marchand, du narrateur que : « ... pendant quatre ans [il va] traîner son accablement et sa mélancolie , les imposant à ses amis, à ses proches, jusqu'à la délivrance, enfin, à la libération. » Normal que, dans la foulée, il en fasse autant pour le public, lequel voudra bien s'apitoyer sur sa souffrance avec toute la commisération d'une Mère Thérésa des lettres, sans toutefois, pour celle qu'il s'inflige ainsi, pouvoir prétendre à la sainteté, le masochisme littéraire n'étant jamais récompensé.
Pour le style, on sera indulgent, vu les vingt ans du narrateur, l'adolescence aime les épanchements -- à la première personne --, et la douleur amoureuse lui est occasion de jouissance. Mais sur six cent trente-deux pages ? L'édition électronique, présente quant à elle, tous les irritants habituels : texte mal édité, césures mal placées, mais à cheval donné...
Ajoutera-t-on que la presse parle déjà de chef-d’œuvre, et murmure le doux et lucratif nom de Goncourt ?
Présentation :
« Le premier amour, paraît-il, n’est jamais que le prélude de la première défaite. On aime, puis on souffre. On essaie de se souvenir pour ne pas vivre, puis on essaie d’oublier – pour ne pas mourir. Mais il n’y a rien de tel qu’essayer d’oublier pour se souvenir, et rien de mieux qu’essayer de se souvenir pour réellement oublier.
» Ces quelques pages racontent l’histoire d’un jeune homme qui comprend, lentement, qu’après avoir aimé une première fois, après avoir une première fois souffert de n’être plus aimé, pour être heureux, il doit réussir à savourer la douleur et le bonheur en même temps, à chaque pas.
» Son chemin est long, plein de détours. Comment en serait-il autrement ? si l’on sait de quoi les premiers amours sont le prélude, on ignore toujours de quoi les premières défaites, à leur tour, peuvent-elles être le commencement. »
Rédigé sur mon iPad.