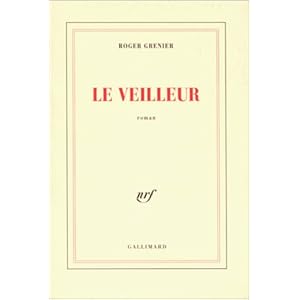Dans le « petit groupe de théâtreux » dont parle Claude, je suis celui qui, « assez contrarié est parti à l'entracte » : effectivement, je n'ai aucunement ressenti l'envie ni le besoin de subir la deuxième partie du spectacle, la première m'ayant déjà suffisamment agacé. J'ajoute donc ici quelques remarques pour m'expliquer.
Le metteur en scène a tenu, dès le lancement de la pièce, à nous avertir : il s'agit d'une pièce de théâtre, et non du monologue d'un humoriste. C'est un défi intéressant. Alors, pourquoi pas ?
Qui dit théâtre dit (bien sûr) personnage(s) : dans cette pièce, alors, quel personnage est censé jouer Benoît Brière ? Le comédien se met-il « dans la peau » de l'« ouvrier », ce personnage écrit par l'auteur Yvon Deschamps, ou dans celle d'Yvon Deschamps-le-monologuiste en train de nous raconter les déboires de l'« ouvrier » (comme il l'a fait autrefois) ? Tout au long de la pièce (non, OK, de la première partie), j'avais l'impression que le comédien sautait de l'un à l'autre. Ajoutons à cela quelques petits trucs empruntés à Olivier Guimond, et l'unité et la clarté en prennent pour leur rhume.
Certains s'étaient demandé, avant d'aller voir la pièce : le texte a-t-il vieilli ? quel effet produira-t-il, 40 ans après sa création ? Moi, la question que je m'étais posée est plutôt la suivante : comment le metteur en scène réussira-t-il à nous faire voir et sentir ce qui est encore actuel (voire intemporel) dans le texte, malgré certains éléments qui renvoient forcément à une époque qui elle, est révolue. Le théâtre est le théâtre justement parce que, pour nous toucher, une pièce n'a pas à nous présenter des événements qui se déroulent au moment où on y assiste. Mais, quand l'action se déroule à une certaine époque – du moins, quand elle est liée de près, comme ici, à une période historique précise dans un pays donné –, il faut que les spectateurs puissent la situer. Or, comme l'écrit Claude, on peut se demander à quelle réalité renvoie la pièce. Ceux qui ont 50 ans et plus peuvent (parfois) y reconnaître le Québec d'avant (ou des débuts de) la Révolution tranquille. Mais les plus jeunes ? (Est-ce que le seul fait de prononcer « téléphone » comme si le mot s'écrivait « téléphône » est censé nous éclairer ?)
Avec ses monologues, Yvon Deschamps nous faisait rire, bien sûr – ne serait-ce que grâce à certains jeux de mots, toujours aussi drôles. Mais on riait aussi parce qu'il nous renvoyait une image de nous pas nécessairement très drôle, mais assez juste et dont certains éléments, poussés à l'extrême, nous permettaient de rire (même de nous) avec cœur. Il y avait beaucoup de tendresse dans les monologues d'Yvon Deschamps ; il aimait son personnage, et il ne le ridiculisait pas. Il parvenait à dénoncer des injustices sociales épouvantables en nous faisant rire avec son personnage, et non de son personnage. Or, l'« ouvrier » de Benoit Brière et de Dominic Champagne ressemble très souvent à un attardé mental, entre autres à cause de ses nombreux tics et de sa façon de se déplacer (même quand il n'a que quelques pas à faire, sa démarche est si incertaine qu'on se demande si le personnage, censé avoir une trentaine d'années, n'en a pas plutôt 90).
Dès lors, le sens du texte d'Yvon Deschamps est complètement évacué : effectivement, pour vivre et réagir comme le fait le personnage, il faut être niaiseux (dixit Claude), ou avoir des problèmes de santé mentale qui empêchent de vivre « normalement ». Les inégalités sociales qu'Yvon Deschamps dénonçaient n'ont plus de place ici : la société n'est peut-être pas toujours juste, mais il faut vraiment être niaiseux pour s'y laisser prendre et en souffrir à ce point.
Plus encore : le personnage joué par Benoît Brière n'a aucune vraisemblance tellement la caricature est poussée. Pourquoi nous souligner trois fois au crayon gras ce que le texte dit déjà clairement ? On voudrait gommer le caractère presque tragique de certaines situations ou de certaines répliques qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Derrière la peinture « sociale » d'une époque donnée de l'histoire du Québec, il y a aussi, dans le texte d'Yvon Deschamps, quelque chose de terriblement dramatique et touchant, qui est lié, dirai-je – faute de trouver des mots moins galvaudés –, à la « difficulté de vivre » dans une société où une minorité utilise tous les pouvoirs pour maintenir sa domination et ses privilèges. Et, pour rendre cela au théâtre, rien de mieux que la sobriété : les spectateurs sont capables eux-mêmes d'entendre et de voir ce qu'ils entendent et voient, d'en rire, de s'en indigner ou d'en pleurer, sans qu'un comédien se promène sur la scène avec une pancarte « Ici, c'est drôle ! » ou « Ici, c'est triste ».
Bref, oui, cette « moitié de pièce » m'a beaucoup agacé.
Jean B.
P.-S. Je m'excuse, auprès des autres membres du groupe de théâtreux, d'avoir grimpé dans les rideaux. Je l'avoue, c'est parfois ainsi que je réagis quand un spectacle me donne l'impression qu'on me prend pour plus imbécile que je ne le suis. Et j'invoque des circonstances atténuantes : la grippe, ça me rend plus vite impatient.
mercredi 23 février 2011
Une pièce, non ce n'est pas ça : La mort du boss (suite)
L'ami qui s'était éclipsé à l'entracte, non sans avoir manifesté quelque humeur, m'a fait tenir son propre commentaire de la « pièce », qu'il m'a permis, je l'en remercie, de partager avec vous.
dimanche 20 février 2011
Une pièce, non ce n'est pas ça : La mort du boss
Réaction mitigée de mon petit groupe de théâtreux à la sortie du Quat'Sous hier soir après la représentation de La mort du boss d'Yvon DESCHAMPS. Un quadragénaire, cinq quinquagénaires et un sexagénaire. Si l'un d'entre nous a quitté à l'entracte, assez contrarié, les autres sont restés jusqu'à la fin; nous serions ainsi d'incorrigibles optimistes.
Une pièce insiste le programme. Par parenthèses, si l'on peut reconnaître à la spontanéité d'incontestables vertus, on reprochera, ce n'est pas la première fois, au directeur artistique sa légèreté (« ce spectacle... Je ne prends pas le temps de réfléchir et j'accepte aussitôt »); à quoi peut bien servir, dans ces conditions, un directeur artistique ? On trouvera bien dans ses brouillons nombre de projets à monter « sans réfléchir » : devrait-on, dès lors, le contacter ? Cela dit, n'étant pas des intimes de celui-ci, ni du milieu, l'on ne nourrira aucune illusion sur la possibilité de bénéficier de ce si spontané « patronage » culturel...
Une pièce ? plutôt un collage de sketches anciens (un recyclage culturel, en quelque sorte) où l'on assiste au long soliloque d'un ouvrier niaiseux pris dans les rets d'une inexorable aliénation. Son enfance, son entrée à la shop et le drame d'une vie confinée à la misère, à l'absence d'amour, à la maladie et à la mort; seul, forcément seul, cruellement seul.
Or, d'entrée, le boss meurt; lequel « représente Dieu, c'est sa raison d'être ». Le personnage tente en vain de se faire une raison, mais, pour lui, cette mort est bien plus cruelle que celle de ses parents ou des sa femme. Il ne peut envisager ni pour lui-même, ni pour son fils, le moindre avenir : le monde est immuable, rien ne doit ni ne peut changer. La mort, d'ailleurs, est le seul personnage avec qui il lui semble possible de communiquer, et qui lui montre un peu de sympathie. Et pourtant, il trouve le moyen de rater son rendez-vous avec elle.
Le personnage, rappelons-le, a vu le jour à la fin des années soixante, dans le cadre d'un spectacle, l'Osstidsho, qui, avec Les belles-sœurs de TREMBLAY, aura marqué l'irruption sur la scène de la génération qui allait, par la suite, recevoir le nom de baby-boomers. Certes, il y aura toujours des perdants, mais représentait-il encore la réalité du monde ouvrier ? ou bien ne décrivait-il pas un personnage de la crise de 1929 et des années de la guerre -- l'auteur ne cache pas son admiration pour le Ti-Coq de Gratien GÉLINAS --, un personnage d'avant la Révolution tranquille ? N'était-ce pas de la vieille génération qu'il se moquait ? On aimerait connaître l'avis d'historiens et sociologues sur ces questions. En tout cas, s'il ne semble pas encore archaïque aux gens de cette génération (la majorité du public hier soir), et qui ont, naguère, fait le succès des monologues de l'auteur, il doit paraître tel à ceux des générations suivantes.
Quelle vision sinistre et pessimiste du monde, et désespérée. Et, on peut le craindre, caricaturale, d'où une certaine gène dans le rire. Pas de révolution, ni tranquille, ni violente pour ce niaiseux qui rate tout même sa mort. N'est-il pas piquant, par ailleurs, qu'au moment où triomphe ce spectacle d'échec et de résignation, un monde d'aliénation et de domination tremble au Maghreb et dans le Golfe ?
Mais nous sommes, ici, gens de patience, étapistes comme ils disent. Et bien catholiques encore.
Ce qui ne laisse pas de m'inquiéter, et augure bien mal de notre avenir.
Une pièce insiste le programme. Par parenthèses, si l'on peut reconnaître à la spontanéité d'incontestables vertus, on reprochera, ce n'est pas la première fois, au directeur artistique sa légèreté (« ce spectacle... Je ne prends pas le temps de réfléchir et j'accepte aussitôt »); à quoi peut bien servir, dans ces conditions, un directeur artistique ? On trouvera bien dans ses brouillons nombre de projets à monter « sans réfléchir » : devrait-on, dès lors, le contacter ? Cela dit, n'étant pas des intimes de celui-ci, ni du milieu, l'on ne nourrira aucune illusion sur la possibilité de bénéficier de ce si spontané « patronage » culturel...
Une pièce ? plutôt un collage de sketches anciens (un recyclage culturel, en quelque sorte) où l'on assiste au long soliloque d'un ouvrier niaiseux pris dans les rets d'une inexorable aliénation. Son enfance, son entrée à la shop et le drame d'une vie confinée à la misère, à l'absence d'amour, à la maladie et à la mort; seul, forcément seul, cruellement seul.
Or, d'entrée, le boss meurt; lequel « représente Dieu, c'est sa raison d'être ». Le personnage tente en vain de se faire une raison, mais, pour lui, cette mort est bien plus cruelle que celle de ses parents ou des sa femme. Il ne peut envisager ni pour lui-même, ni pour son fils, le moindre avenir : le monde est immuable, rien ne doit ni ne peut changer. La mort, d'ailleurs, est le seul personnage avec qui il lui semble possible de communiquer, et qui lui montre un peu de sympathie. Et pourtant, il trouve le moyen de rater son rendez-vous avec elle.
Le personnage, rappelons-le, a vu le jour à la fin des années soixante, dans le cadre d'un spectacle, l'Osstidsho, qui, avec Les belles-sœurs de TREMBLAY, aura marqué l'irruption sur la scène de la génération qui allait, par la suite, recevoir le nom de baby-boomers. Certes, il y aura toujours des perdants, mais représentait-il encore la réalité du monde ouvrier ? ou bien ne décrivait-il pas un personnage de la crise de 1929 et des années de la guerre -- l'auteur ne cache pas son admiration pour le Ti-Coq de Gratien GÉLINAS --, un personnage d'avant la Révolution tranquille ? N'était-ce pas de la vieille génération qu'il se moquait ? On aimerait connaître l'avis d'historiens et sociologues sur ces questions. En tout cas, s'il ne semble pas encore archaïque aux gens de cette génération (la majorité du public hier soir), et qui ont, naguère, fait le succès des monologues de l'auteur, il doit paraître tel à ceux des générations suivantes.
Quelle vision sinistre et pessimiste du monde, et désespérée. Et, on peut le craindre, caricaturale, d'où une certaine gène dans le rire. Pas de révolution, ni tranquille, ni violente pour ce niaiseux qui rate tout même sa mort. N'est-il pas piquant, par ailleurs, qu'au moment où triomphe ce spectacle d'échec et de résignation, un monde d'aliénation et de domination tremble au Maghreb et dans le Golfe ?
Mais nous sommes, ici, gens de patience, étapistes comme ils disent. Et bien catholiques encore.
Ce qui ne laisse pas de m'inquiéter, et augure bien mal de notre avenir.
mercredi 16 février 2011
Régime
Certaines soirées, surtout de celles qui sont bien arrosées et se poursuivent bien avant dans la nuit, se rappellent à votre bon souvenir le jour venu : l'eau minérale et le thé de Japon, bien léger, sont alors les bienvenus. Il n'en va pas autrement des livres, mais en la circonstance, le thé n'est d'aucune utilité. Avec le temps, j'ai appris, pour me remettre d'une indigeste lecture, à me plonger dans un dictionnaire. Le Trésor de la langue française, riche en exemples, sur la Toile, vous remettra sur pied, littéralement et littérairement, en un rien de temps et vous fera oublier ces textes qui vous ont tant fait souffrir. En quelque sorte, un spa pour l'esprit.
J'ai aussi, pour la cure de désintoxication des proses médiocres, recours aux recueils des chroniques du Maître de la critique de la fin du siècle dernier : Angelo RINALDI. Quel style. Il vous en éreinte un comme pas un, certes, mais il n'a pas son pareil pour vous donner le goût de découvrir un auteur. J'en suis à déguster son récent opus, Dans un état critique, et je fus requinqué par sa chronique sur les lettres de Madame PALATINE, celle que PROUST appelait « la femme de la Tante, l'épouse de Monsieur, le frère de Louis XIV, lequel, tout belliqueux qu'il fût, inclinait du côté de Sodome.
Et, quelques pages plus loin, voici la critique d'un bref roman de Roger GRENIER, dont RINALDI rappelle que, « illustrateur des faillites, [il] écrit sec » et toujours « sut en trois phrases donner l'impression de la durée, capter le flot amer du temps, dont son œuvre, en sa grisaille sans miséricorde, reproduit le mouvement de ressac, chaque livre ayant poussé l'autre, comme les vagues ». C'était à propos du roman Le veilleur, paru chez Gallimard il y a une dizaine d'années. Vous aurez compris que GRENIER est de ces auteurs qui viennent du côté de chez TCHÉKHOV dont je suis grand amateur, et chez qui la mélancolie ne s'accompagne pas d'un sirupeux fond sonore. L'heure tardive ne m'a pas retenu de le reprendre; dix ans ! ce n'est plus le même homme qui relit, c'est à se demander, même, si on l'a déjà lu ce court roman. Quelques annotations l'attestent, et pourtant, tout est comme nouveau. Et me voici tout à fait guéri.
Mais, cher lecteur, inutile d'attendre la prochaine grippe pour le lire.
Roger GRENIER, Le veilleur,Gallimard, Paris, 2000 (143 pages).
Angelo RINALDI, de l'Académie française, Dans un état critique, La découverte, Paris, 2010 (406 pages).
J'ai aussi, pour la cure de désintoxication des proses médiocres, recours aux recueils des chroniques du Maître de la critique de la fin du siècle dernier : Angelo RINALDI. Quel style. Il vous en éreinte un comme pas un, certes, mais il n'a pas son pareil pour vous donner le goût de découvrir un auteur. J'en suis à déguster son récent opus, Dans un état critique, et je fus requinqué par sa chronique sur les lettres de Madame PALATINE, celle que PROUST appelait « la femme de la Tante, l'épouse de Monsieur, le frère de Louis XIV, lequel, tout belliqueux qu'il fût, inclinait du côté de Sodome.
Et, quelques pages plus loin, voici la critique d'un bref roman de Roger GRENIER, dont RINALDI rappelle que, « illustrateur des faillites, [il] écrit sec » et toujours « sut en trois phrases donner l'impression de la durée, capter le flot amer du temps, dont son œuvre, en sa grisaille sans miséricorde, reproduit le mouvement de ressac, chaque livre ayant poussé l'autre, comme les vagues ». C'était à propos du roman Le veilleur, paru chez Gallimard il y a une dizaine d'années. Vous aurez compris que GRENIER est de ces auteurs qui viennent du côté de chez TCHÉKHOV dont je suis grand amateur, et chez qui la mélancolie ne s'accompagne pas d'un sirupeux fond sonore. L'heure tardive ne m'a pas retenu de le reprendre; dix ans ! ce n'est plus le même homme qui relit, c'est à se demander, même, si on l'a déjà lu ce court roman. Quelques annotations l'attestent, et pourtant, tout est comme nouveau. Et me voici tout à fait guéri.
Mais, cher lecteur, inutile d'attendre la prochaine grippe pour le lire.
Roger GRENIER, Le veilleur,Gallimard, Paris, 2000 (143 pages).
Angelo RINALDI, de l'Académie française, Dans un état critique, La découverte, Paris, 2010 (406 pages).
lundi 14 février 2011
Arabesques
Pierre SAMSON, Arabesques, Les herbes rouges, Montréal, 2010 (505 pages).
« Toute bonne chose a une fin » déplore la sagesse populaire. En l'espèce, si l'on entend par là qu'elle doit avoir une limite, on remerciera le ciel que les moins bonnes en aient une aussi, dussent-elles se répandre sur plus de cinq cents pages. S'il s'agit d'un but, on s'en réjouira également, car l'auteur l'aura atteint en nous racontant comment des spéculateurs viennent à bout de la résistance des habitants d'un îlot du quartier Hochelaga à Montréal qui seront finalement expulsés de leur très sweet home.
On pourrait voir une métaphore de la société québécoise, renfermée sur elle-même et hostile tant au changement qu'aux étrangers, auquel cas, on pourra, vu la chute, s'étonner du pessimisme de l'auteur sur notre triste destin.
L'auteur, qui, avec sa bouillotte de scribe accroupi de la quatrième dynastie, nous lance depuis sa quatrième de couverture une œillade sardonique se préoccupe beaucoup de la forme -- ce qui ferait de lui un candidat idéal au Parnasse, si ce club littéraire est encore preneur -- d'où le titre et la construction de l'ouvrage en multiples méandres, qui feront voyager le lecteur, et dans l'espace, le conduisant jusqu'aux Indes et au Brésil, et dans le temps, avec des bribes sur l'histoire du quartier et des personnages.
Formel également le choix d'une certaine préciosité du vocabulaire; ce choix découle d'un commentaire d'un roman précédant affirmant que notre auteur écrivait comme s'il voulait se faire publier en France. Piqué, il en remet une couche, comme on dit en France, justement, estimant que les Québécois n'ont pas à se satisfaire d'un vocabulaire pauvre. Las, si l'on peut savoir gré à l'auteur de favoriser le recours au dictionnaire presque à chaque page, on doutera que son lecteur tirera quelque profit, hors les mots croisés et le Scrabble, fût-ce dans quelque salon ultramontain, à retenir ce que sont népanthès, senestrorsum, faldistoire, volvation et autres rudérations. Préciosité qui confine au ridicule, car elle équivaut à enfiler les termes rares, savants ou didactiques comme des billes de verre sur un collier de pacotille destiné à des touristes en mal d'exotisme. Encore lui faudrait-il se soucier un peu de la grammaire, laquelle est fort malmenée, et, avant de porter des coups de griffe à PROUST, ne pas confondre cuistrerie et style, vanité et littérature.
Ce qui est bien dommage, car pour peu qu'il s'oublie un peu, c'est à dire lorsqu'il qu'il ne se regarde pas écrire, l'auteur sait emporter son lecteur et susciter, de trop fugaces instants, un réel plaisir. Au lieu de quoi, il donne dans un pompiérisme (terme que devrait lui plaire) flamboyant et abandonne son lecteur, accablé, au bord du chemin. Enfin, si l'on peut aimer la technique de peinture des personnages l'un par l'autre, on n'arrive pas à les distinguer l'un de l'autre car tous partagent la même voix et le même style ampoulé et, partant, perdent leur identité dans un sirupeux magma : aurait-on affaire à des avatars de l'auteur, qui ne peut s'empêcher de nous sermonner au passage ?
On aura écrit ce commentaire d'autant plus librement que l'auteur, par la voix d'un des membres des son quatuor, récuse toute critique et envoie paître le contradicteur.
Cela étant, cher public, achetez ce livre, l'auteur, qui aime plaire, vous en sera reconnaissant. Et, accessoirement, lisez-le, ou mieux, le Trésor de la langue française.



« Toute bonne chose a une fin » déplore la sagesse populaire. En l'espèce, si l'on entend par là qu'elle doit avoir une limite, on remerciera le ciel que les moins bonnes en aient une aussi, dussent-elles se répandre sur plus de cinq cents pages. S'il s'agit d'un but, on s'en réjouira également, car l'auteur l'aura atteint en nous racontant comment des spéculateurs viennent à bout de la résistance des habitants d'un îlot du quartier Hochelaga à Montréal qui seront finalement expulsés de leur très sweet home.
On pourrait voir une métaphore de la société québécoise, renfermée sur elle-même et hostile tant au changement qu'aux étrangers, auquel cas, on pourra, vu la chute, s'étonner du pessimisme de l'auteur sur notre triste destin.
L'auteur, qui, avec sa bouillotte de scribe accroupi de la quatrième dynastie, nous lance depuis sa quatrième de couverture une œillade sardonique se préoccupe beaucoup de la forme -- ce qui ferait de lui un candidat idéal au Parnasse, si ce club littéraire est encore preneur -- d'où le titre et la construction de l'ouvrage en multiples méandres, qui feront voyager le lecteur, et dans l'espace, le conduisant jusqu'aux Indes et au Brésil, et dans le temps, avec des bribes sur l'histoire du quartier et des personnages.
Formel également le choix d'une certaine préciosité du vocabulaire; ce choix découle d'un commentaire d'un roman précédant affirmant que notre auteur écrivait comme s'il voulait se faire publier en France. Piqué, il en remet une couche, comme on dit en France, justement, estimant que les Québécois n'ont pas à se satisfaire d'un vocabulaire pauvre. Las, si l'on peut savoir gré à l'auteur de favoriser le recours au dictionnaire presque à chaque page, on doutera que son lecteur tirera quelque profit, hors les mots croisés et le Scrabble, fût-ce dans quelque salon ultramontain, à retenir ce que sont népanthès, senestrorsum, faldistoire, volvation et autres rudérations. Préciosité qui confine au ridicule, car elle équivaut à enfiler les termes rares, savants ou didactiques comme des billes de verre sur un collier de pacotille destiné à des touristes en mal d'exotisme. Encore lui faudrait-il se soucier un peu de la grammaire, laquelle est fort malmenée, et, avant de porter des coups de griffe à PROUST, ne pas confondre cuistrerie et style, vanité et littérature.
Ce qui est bien dommage, car pour peu qu'il s'oublie un peu, c'est à dire lorsqu'il qu'il ne se regarde pas écrire, l'auteur sait emporter son lecteur et susciter, de trop fugaces instants, un réel plaisir. Au lieu de quoi, il donne dans un pompiérisme (terme que devrait lui plaire) flamboyant et abandonne son lecteur, accablé, au bord du chemin. Enfin, si l'on peut aimer la technique de peinture des personnages l'un par l'autre, on n'arrive pas à les distinguer l'un de l'autre car tous partagent la même voix et le même style ampoulé et, partant, perdent leur identité dans un sirupeux magma : aurait-on affaire à des avatars de l'auteur, qui ne peut s'empêcher de nous sermonner au passage ?
On aura écrit ce commentaire d'autant plus librement que l'auteur, par la voix d'un des membres des son quatuor, récuse toute critique et envoie paître le contradicteur.
Cela étant, cher public, achetez ce livre, l'auteur, qui aime plaire, vous en sera reconnaissant. Et, accessoirement, lisez-le, ou mieux, le Trésor de la langue française.

lundi 7 février 2011
Arabesques
Pierre SAMSON, Arabesques, Les herbes rouges, Montréal, 2010 (505 pages).
 L'ami faisant preuve de patience, je chemine laborieusement dans les entrelacs de ces Arabesques. La séduction avait opéré, elle s'est un peu émoussée depuis, et alors je n'en suis qu'à 382 pages, j'ai la forte impression que me gagne la lassitude résignée des vieux couples : « Bien sûr, nous eûmes des orages...». Comble de malheur, d'autres livres sont arrivés chez mon libraire et à la bibliothèque : résisterai-je à la tentation ? Ou vais-je, invoquant Pierre BAYARD, vous parler d'un livre que je n'aurai pas lu jusqu'à fin ?
L'ami faisant preuve de patience, je chemine laborieusement dans les entrelacs de ces Arabesques. La séduction avait opéré, elle s'est un peu émoussée depuis, et alors je n'en suis qu'à 382 pages, j'ai la forte impression que me gagne la lassitude résignée des vieux couples : « Bien sûr, nous eûmes des orages...». Comble de malheur, d'autres livres sont arrivés chez mon libraire et à la bibliothèque : résisterai-je à la tentation ? Ou vais-je, invoquant Pierre BAYARD, vous parler d'un livre que je n'aurai pas lu jusqu'à fin ?
 L'ami faisant preuve de patience, je chemine laborieusement dans les entrelacs de ces Arabesques. La séduction avait opéré, elle s'est un peu émoussée depuis, et alors je n'en suis qu'à 382 pages, j'ai la forte impression que me gagne la lassitude résignée des vieux couples : « Bien sûr, nous eûmes des orages...». Comble de malheur, d'autres livres sont arrivés chez mon libraire et à la bibliothèque : résisterai-je à la tentation ? Ou vais-je, invoquant Pierre BAYARD, vous parler d'un livre que je n'aurai pas lu jusqu'à fin ?
L'ami faisant preuve de patience, je chemine laborieusement dans les entrelacs de ces Arabesques. La séduction avait opéré, elle s'est un peu émoussée depuis, et alors je n'en suis qu'à 382 pages, j'ai la forte impression que me gagne la lassitude résignée des vieux couples : « Bien sûr, nous eûmes des orages...». Comble de malheur, d'autres livres sont arrivés chez mon libraire et à la bibliothèque : résisterai-je à la tentation ? Ou vais-je, invoquant Pierre BAYARD, vous parler d'un livre que je n'aurai pas lu jusqu'à fin ?
S'abonner à :
Messages (Atom)